Philip K. Dick : Romans 1953-1959
premier tome de la réédition des principaux romans de Science-Fiction de l'auteur, 2012
« Je ne suis pas romancier mais “philosophe romanceur” ; le don d'écrire est l'instrument qui me sert à formuler ma vision. Le propos de mon œuvre n'est pas l'art, mais la vérité. Ainsi, mes histoires sont la vérité, mais il n'y a rien que je puisse faire pour l'édulcorer, que ce soit par les actes ou par l'explication. »
Philip K. Dick (1928-1982) est l'un des plus extraordinaires écrivains américains de la deuxième moitié du xxe siècle. Non ! le plus extraordinaire. À tous les sens du terme.
L'homme, son œuvre et son audience regorgent de paradoxes et d'incertitudes.
Côté paradoxes, la première ambition littéraire de Dick est de s'imposer comme un auteur de littérature générale : entre 1950 (il a vingt-deux ans) et 1960, il ne produit pas moins de douze romans réalistes, tous refusés par les éditeurs, sans doute nombreux, auxquels ils furent soumis. C'est le succès de ses romans de Science-Fiction qui en conduira, tardivement, certains à envisager leur publication : le premier, Confessions of a crap artist, écrit en 1959, ne sera publié qu'en 1975 par un minuscule éditeur américain.(2) À les lire, on comprend l'hésitation des éditeurs. Ils ne sont pas exécrables mais leur auteur n'a trouvé ni sa voix ni sa voie. De surcroît, Dick y met régulièrement en scène des misfits, des médiocres, des paumés, pas même vraiment des ratés. En un sens, il préfigure, l'alcool en moins, des écrivains comme son contemporain Charles Bukowski (1920-1994) qui ne publiera de romans qu'à partir de 1971. On retrouvera au demeurant de semblables personnages et de telles situations d'échec dans ses œuvres de Science-Fiction. Toute sa vie, il aurait aimé être adoubé par la Beat Generation, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs, ou du moins lui être associé dans l'estime du public. Cela lui fut-il refusé, comme le pense Lawrence Sutin, parce que la plus grande partie de son œuvre relève d'un genre encore plus décrié aux États-Unis qu'en France, la Science-Fiction ? C'est vraisemblable. Ou bien parce qu'il est, comme Bukowski, d'origine beaucoup plus modeste qu'eux. Cela compte aussi. Assez injustement, les quatre écrivains précités sont associés comme lui à la Counter Culture, concept diffus et journalistique inventé par Theodore Roszak,(3) qui rassemble dans toutes ses variétés ce que nous appelons culture populaire, mais ils ont fait leur trou dans la culture classique, paradis dont l'entrée lui demeure interdite. Burroughs a pourtant, lui aussi, flirté avec la Science-Fiction et exercé une influence manifeste sur J.G. Ballard à travers ses cut-ups et sa littérature déconstruite.
Indirectement, Dick fut tout de même associé à la Beat Generation puisque le titre Blade runner du film inspiré par son roman les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?(4) fut emprunté à Burroughs.(5) Aurait-il gagné à l'être de plein exercice ? On peut en douter : moins original et plus emprunté sur le terrain littéraire que ses prédécesseurs, il risquait de passer pour un second couteau. En désespoir de cause, il se tourne vers la Science-Fiction, genre qu'il connaît depuis son enfance, mais il s'y risque visiblement sans grand enthousiasme dans ses premiers essais. J'y reviendrai.
Un deuxième paradoxe tient à ses audiences. Il ne rencontre jamais, au moins de son vivant, un grand succès aux États-Unis, et même encore aujourd'hui il y est considéré comme un écrivain de second voire de troisième rang, un auteur de genre. En France et même en Grande-Bretagne,(6) si l'accueil n'est pas immédiatement triomphal, il est vite considéré, après 1968, comme un écrivain novateur et de premier plan qui séduit des intellectuels et des critiques bien au-delà du domaine spécialisé. Son destin littéraire reproduit dans une certaine mesure celui de son grand prédécesseur américain, Edgar Allan Poe (1809-1849), considéré en son temps et peut-être aujourd'hui encore avec une certaine distance par l'établissement littéraire de son pays(7) alors que son succès fut en France rapide et durable grâce, certes, aux traductions de Charles Baudelaire.
Un troisième paradoxe tient à sa descendance cinématographique. Pas moins de douze films, peut-être treize, ont été adaptés de romans ou plus souvent de nouvelles de Philip K. Dick alors qu'aucun de ses livres n'a jamais été auparavant un bestseller, ce qui est la règle à Hollywood. Et cela dès 1982, l'année hélas de sa mort. Ces adaptations sont très inégales pour dire le moins ; aucune ne dérive d'une œuvre majeure de Dick(8) et toutes, sauf une, relèvent de la Science-Fiction.
Un quatrième paradoxe, plus subtil, tient à la caractérisation de Dick comme auteur postmoderne par certains critiques universitaires et autres,(9) ce qui peut se comprendre. La dimension baroque des univers de Dick fonde aisément cette assertion. Si l'on considère le célèbre début d'Ubik(10) et le dialogue tragique et désopilant entre Joe Chip et sa porte qui exige pour s'ouvrir une pièce de monnaie, les vaporisateurs d'Ubik qui évoquent les soupes Campbell d'Andy Warhol, ou encore l'usage, par des prolétaires exilés sur d'autres mondes dans les conapts de Cités (tristement) Radieuses, de poupées façon Barbie et Ken(11) pour se créer des mondes de substitution et d'évasion (virtuels ? mais le terme n'existe pas encore dans cette acception), on peut se le demander. Au surplus, Dick ne souscrit pas vraiment aux thèmes, tropes et traditions modernistes de la Science-Fiction, sauf sous sa forme New Wave bien qu'il n'ait jamais été rattaché à cette école. Quand il les récupère, c'est souvent sur son mode décalé et ironique.
Mais d'abord, qu'est-ce qu'être postmoderne ?
La modernité, dont l'idéologie est le modernisme, a été, en gros, inventée au xviiie siècle. L'idée est qu'il y a des règles, celles de la nature, qu'on connaît de mieux en mieux, et que le respect de ces règles a des effets positifs, tant sur l'esthétique que sur la condition humaine en général. La différence d'avec le classicisme qui a précédé la modernité, c'est que celui-là fondait ses règles sur la religion et quelques conventions sociales comme la monarchie. Les Lumières qui introduisent à la modernité leur préfèrent des règles en principe fondées sur la raison et la science. Le modernisme atteindra l'un de ses sommets avant sa chute avec le style épuré et fonctionnaliste du Bauhaus. Sa variété franco-suisse qui n'est pas ma préférée fut incarnée par Le Corbusier, l'architecte de la Cité Radieuse.
Il faut noter ici que le modernisme a produit ses propres monstres sous couvert de rationalité, la Terreur, la guerre totale, les Communismes soviétique et maoïste, et par réaction le Fascisme et le Nazisme, plus quelques autres. Dick leur fait une place.
Le postmoderne et son idéologie, le postmodernisme, prennent le contre-pied de la modernité. C'est le rejet de toute règle, de toute contrainte et de tout fonctionnalisme. Chacun fait comme il veut, c'est le règne de l'individualisme, du subjectivisme, voire du relativisme. Cela ne signifie pas que toute référence au passé est abolie, au contraire : chacun y puise à son goût, l'emprunt allant du plagiat au pastiche en passant par la citation, et cultive volontiers le baroque voire le kitsch. Stricto sensu, le terme semble avoir été introduit en 1977 par l'architecte Charles Jenck. Mais bien entendu le basculement ne s'est pas fait en un jour et je le ferais volontiers remonter au moins aux années 1950, précisément celles où Dick commence à écrire, au moment où le monde développé sort enfin de la Grande Crise des années 1930, et de l'après Seconde Guerre mondiale en attendant la troisième.(12) En architecture, le style postmoderne consiste à renoncer au fonctionnalisme pour proposer des bâtiments en forme de ruines modernes, à procéder à des collages de créneaux sur des HLM, ou encore à donner des formes rondes de donjons à des appartements, interdisant tout usage de meubles normaux. En art, sévissent l'exaltation du kitsch (Jeff Koons) et les installations dont je me souviens avoir vu des empilements de verres à pied et plus récemment des cercles de chaussures féminines à haut talon.(13) Tout cela est assez dickien. En littérature, on peut relever la récupération de thèmes empruntés aux littératures dites populaires ou encore de genre, et, plus spécialement en France, l'auto-fiction : l'égotisme prime, voire l'égoïsme. En philosophie, le postmodernisme a pour chantres Jean-François Lyotard, Jacques Derrida et Julia Kristeva qui font des malheurs, hélas, outre-Atlantique. Et enfin, en épistémologie, Paul Feyerabend proclame qu'en sciences, tout est bon à prendre (everything goes), et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui.
Bref, la modernité, c'est la croyance ou du moins la confiance dans le progrès. La relation avec le progrès est simple : mieux on connaît les lois de la nature, plus on peut les utiliser en faveur de la condition humaine pour le meilleur. Ou certes pour le pire.
La postmodernité, c'est la négation de la possibilité d'un progrès ou du moins la défiance à son endroit. Et dans bien des cas, cela me semble rejoindre le rejet de la démarche scientifique et de ses acquis, ce qui suscite de ma part une suspicion certaine.
Fredric Jameson, en bon marxiste et par ailleurs commentateur averti de Dick, définit le postmodernisme comme « la logique culturelle du capitalisme tardif »
,(14) en quoi, en bon marxien, je lui donnerai volontiers raison. À la satisfaction des besoins prônée par le fordisme, le New Deal et la reconstruction d'après-guerre, se substituent la nécessité de produire sans cesse du nouveau devant le péril d'une saturation de la demande, et la recherche de l'originalité à tout prix. Il s'ensuit une profusion proprement insensée de produits dérivés de rêves artificiels et destinés à susciter des demandes artificielles. Ubik, le produit protéiforme destiné à calmer toutes les craintes et à satisfaire tous les désirs, en est l'aboutissement ultime. En économie, le postmodernisme me semble se caractériser par la désindustrialisation, le culte de l'immatériel et la multiplication des bulles financières. Un aspect important du contexte inquiétant dans lequel se développe le postmoderne, aspect que l'on retrouve souvent dans l'œuvre de Dick, c'est l'opacité des organisations et des processus économiques et financiers, celle de la politique et, pour des raisons toutes différentes, des sciences. À cette opacité, le postmoderne oppose à la fois un rejet, un refus de l'effort de compréhension (« ce n'est pas mon truc ») et un recours à la superficialité valorisée, à la juxtaposition d'éléments, voire de clichés, supposés connus, transparents et donc rassurants. Toute la question du postmodernisme est qu'il est suspendu entre l'exploitation cynique de ces juxtapositions et la dénonciation ironique de ce contexte angoissant. Comme le déclarait Andy Warhol : « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n'y a rien dessous. »
.(15)
Tout cela rend étrange à mes yeux la position de certains théoriciens de la Science-Fiction qui voudraient ranger la Science-Fiction tout entière sous la bannière du postmoderne, redoutant peut-être de la voir se démoder ou espérant par là lui donner du lustre au moment où certains estiment le postmodernisme dépassé.(16) L'écrasante majorité des auteurs contemporains de Science-Fiction adhèrent sans réserve aux valeurs de la modernité. Cela est évident pour ceux qui se réclament du courant hard science. Mais ça ne l'est pas moins pour ceux qui, critiquant la société du “capitalisme tardif” sous ses aspects écologiques, économiques, politiques et sociaux, appellent de leurs vœux un retour aux valeurs susdites. Que les auteurs de Science-Fiction aient décrit et dénoncé les travers du monde dit postmoderne, je n'en doute pas ; ça n'en fait pas des postmodernes, au contraire. Au fond, le réalisme est le ressort profond de la Science-Fiction même s'il cherche ses racines le plus souvent dans l'avenir. L'uchronie elle-même, que retiendra Dick dans le Maître du Haut Château,(17) renvoie à une réflexion sur ce que l'histoire aurait pu être plutôt qu'à une nostalgie. Dans une certaine mesure, toutefois, quand la Science-Fiction se cite, se parodie, elle vire au postmoderne. Son intertextualité perd alors de sa force collective pour tourner au ressassement, ironique dans le meilleur des cas.
En revanche, la Fantasy, même dans sa variété urbaine, et le roman paranormal avec ses vampires, zombies et autres loups-garous me semblent bien relever du postmoderne. Le passéisme de façade et de convention, la reprise répétitive des mêmes thèmes, la distance appuyée d'avec toute actualité voire le mépris de la rationalité, correspondent aux caractéristiques décrites par Jameson et d'autres.(18)
Alors, Philip K. Dick est-il ou non un écrivain postmoderne ?
À sa manière, Dick avait conscience du paradoxe même s'il n'utilise pas le terme de postmoderne. Il note en 1978 : « Mon écriture n'est pas belle ; je me contente de faire un rapport sur notre situation à l'intention de ceux qui ne sont pas dans un cercueil cryo. Je suis un analyseur. »
. Et ailleurs : « Je déniche constamment des problématiques elliptiques, des angles d'approche inhabituels. Ce que j'écris n'a guère de sens dans l'ensemble. […] Merde, c'est comme un cirque. Je suis comme une pie à l'œil perçant épiant tout ce qui scintille pour le ramasser et le rajouter à son magot. »
. Ce qui correspond tout à fait à l'esthétique postmoderne. Mais son objectif est ailleurs : « C'est vrai, je crois que je suis attiré par ce qui ne vaut rien ou presque, comme si c'était là que résidait la réponse, l'indice suprême. […] Celui qui adopte une attitude pareille est susceptible de tomber par hasard et par chance (au cours de sa vie, c'est-à-dire sa vie spirituelle) sur l'authentique Dieu camouflé, le deus absconditus […]. »
.(19)
Ainsi Dick, dans ses recherches aléatoires (« par hasard »
) et son aspiration à la révélation du réel au-delà de la réalité, se place dans la lignée du surréalisme(20) dont il connaît sans doute les icônes picturales (Dalí) mais que sauf ignorance de ma part il ne mentionne pas. On sait le procès que Breton fait à la modernité et à sa rationalité.
On ne peut donc guère rallier Dick au modernisme ? Ce n'est certainement pas un adepte du progrès scientifique et technique comme peuvent l'être un Robert A. Heinlein ou un Arthur C. Clarke : il serait plutôt technophobe. En littérature, d'autre part, le modernisme se traduit souvent par l'appartenance à une avant-garde comme ont pu le faire William S. Burroughs ou Thomas Pynchon. Dick ne relève d'aucun groupe de cette nature.
Son souci d'émancipation et son espoir que la dénonciation des errements du présent et de ses avenirs permette de retrouver des valeurs, le rapprochent un peu (très peu ?) de la modernité. Il stigmatise l'aliénation sous toutes ses formes, de celle du “capitalisme tardif” à celle du maoïsme(21) en leur opposant les drogues psychédéliques(22) et la schizophrénie comme remèdes et portes de la lucidité.(23) Même s'il est profondément et ironiquement pessimiste, et si le progrès scientifique n'est pas son affaire, Dick promeut deux formes de transcendance, celle de l'art notamment par le truchement de poteries que doit réparer le Guérisseur galactique, et celle d'une métaphysique imprégnée de théologie. Ses valeurs ne sont pas vraiment celles de la rationalité mais elles demeurent celles de la vérité incertaine à l'opposé du cynisme postmoderne.
Certains n'ont donc pas hésité à le situer comme un post-postmoderne.
Ainsi s'annule un paradoxe.
Après les paradoxes viennent les incertitudes, plus nombreuses encore et plus profondes.
J'avoue éprouver bien des incertitudes quant à la biographie de Dick, même selon celle de Lawrence Sutin saluée pour son sérieux par tous les spécialistes mais qui confine à l'hagiographie, raisonnée et non dépourvue d'ironie. Ainsi, sur un détail, lorsque Sutin écrit : « Phil a lu plusieurs fois le Finnegan's wake de James Joyce lorsqu'il avait une vingtaine d'années. »
,(24) j'ai un doute. J'ai fréquenté cet énorme texte rédigé dans un sabir européen, dans sa version originale et dans son adaptation française, et je ne pense pas que quiconque puisse le lire plusieurs fois en une année même en y consacrant tout son temps. Je ne mets aucunement en question les capacités intellectuelles exceptionnelles de l'homme et la culture foisonnante qu'il n'a cessé d'acquérir en autodidacte, mais je trouve là Sutin bon public.
Dick se délectait à parler de sa vie et à multiplier les anecdotes, en particulier horrifiques, ainsi lors de son passage à Metz en septembre 1977 en présence de Jacques Goimard et sans doute de Marcel Thaon,(25) sur les circonstances de la mort de sa sœur jumelle Jane à quarante et un jours. Thaon, théoricien de la psychanalyse, attribue à cet événement, certes tragique, une place majeure dans l'œuvre de Dick mais il néglige l'espèce de jouissance avec laquelle Dick l'exploitait. Mon sentiment est que Dick inventait sa vie comme il aurait fait d'une fiction. Les interventions et agressions dont il aurait été la victime de la part de la police locale et de services fédéraux me semblent pour l'essentiel encore plus sujettes à caution. Et il me paraît trop simple de les attribuer à sa seule tendance paranoïaque. Sa personnalité est extraordinairement complexe et je demeure réservé quant aux tentatives faites jusqu'ici pour cerner sa pathologie mentale, à distance et à travers son œuvre. Du reste, Sutin dit : « Selon tous les critères auxquels j'ose me référer, Phil n'était certainement pas cinglé. J'ai d'ailleurs demandé l'avis d'un psychiatre et d'un psychologue qui l'ont traité lors de passages difficiles, et tous deux le déclarent aussi sain d'esprit que vous et moi. »
.(26)
Indiscutablement névrosé et prédisposé à traverser des moments affectifs très pénibles, Dick aimait aussi à passer pour plus fou qu'il n'était. Il est difficile de parler d'expériences très étranges à des gens réputés normaux. Il faut donc les habiller. Comme celles de 1963 et de février-mars 1974.
Sutin n'est pas dupe, qui écrit : Dick « adorait échafauder des hypothèses, extrapoler, interpréter encore et toujours…, mais aussi faire marcher les gens. »
.(27) Et plus loin : « Je suis conscient du fait que les nombreux comptes rendus donnés ici et là par Dick sur sa propre existence sont très probablement teintés d'affabulation […] »
.(28)
Je ne conteste pas ici les déclarations de Dick ni les interprétations de Thaon et de Sutin, mais je fais part de mes incertitudes personnelles.
On me permettra une anecdote dont le premier acte fut plusieurs fois raconté. En septembre 1977, Dick fut invité au festival de Metz par Philippe Hupp. Une conférence était prévue dans une vaste salle des fêtes annexe de la Mairie et donnant sur une grande place. La foule s'y pressa tant la notoriété de Dick était considérable ; elle éclipsait presque celles de Philip José Farmer et de Harlan Ellison, eux aussi invités. Au premier rang étaient assis les notables dont Jacques Goimard, Philippe Curval, sans doute Jacques Chambon, Michel Jeury et Emmanuel Jouanne, les plus dickiens des auteurs français, et moi-même.(29) Dans le fond de la salle, tous les sièges étant occupés, les derniers arrivés s'entassèrent sur quatre rangs tels des sardines. Dick fit une entrée majestueuse, arborant en sautoir une grande croix de bois. Marcel Thaon, qui avait reçu le texte rédigé de l'intervention intitulée Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres, avait passé une bonne partie de la nuit précédente à l'étudier pour en assurer la traduction simultanée à mesure du discours de Dick. Celui-ci s'en tint peu de temps au texte préparé puis au désespoir du malheureux Thaon, le repoussa sur la table, s'avança sur la scène et se mit à improviser une sorte de profession de foi. Thaon, héroïque, traduisit tant bien que mal phrase après phrase. Pour autant que je me souvienne et d'après une tradition transmise par plusieurs témoins oculaires, le texte de l'allocution différait sensiblement du projet rédigé(30) mais il semble qu'il n'ait pas été enregistré ni sténographié, ce qui est regrettable. L'effet du sermon dickien sur l'assistance fut remarquable. Dans un bruit croissant de chaises, la salle se dépeupla et, à la fin, il ne restait guère que le cordon de notables au premier rang, stoïques, devant un Dick imperturbable, intarissable, et un Thaon épuisé et déconfit.
Le lendemain matin, Dick et moi prîmes ensemble le petit-déjeuner. J'étais alors son principal éditeur français mais je le connaissais moins bien que certains des autres auteurs que je publiais. Il était rayonnant, croix de bois dansant sur l'estomac. Je pris mon courage à deux mains et dans le style le plus diplomatique possible, j'osai lui demander si, la veille, il avait été tout à fait sérieux. Il me répondit par un large sourire et cligna lentement et distinctement de l'œil droit. Puis nous passâmes à autre chose.
Je n'ai cessé depuis de m'interroger sur cette réaction. Peut-être en effet n'avait-il pas été la veille tout à fait sérieux, privilégiant le spectacle et en quelque sorte le scandale eu égard à cette assistance, et le reconnaissait-il à mon intention dans cette mimique. Ou bien, ayant parfaitement saisi le scepticisme implicite dans ma question maladroite, il avait choisi de me faire plaisir, de se comporter comme il pouvait supposer que je l'attendais. Allez savoir. À sa façon, dans tous les cas, il était sincère. Incertitude.
« Son sens de l'humour se manifestait par des affirmations assénées de but en blanc avec le plus grand sérieux qui laissaient son auditoire perplexe : était-il en train de plaisanter, ou de faire de curieuses révélations ? Ce qui était d'ailleurs l'effet recherché. »
(31)
La question de son usage de drogues est tout aussi incertaine. Dick lui-même, ses commentateurs, exégètes et thuriféraires disent à ce propos tout et son contraire.
Dick semble admettre un temps qu'il a consommé des substances dont certaines ne sont pas encore alors illicites. Ses lecteurs attentifs qui ont fait des expériences similaires et dont je suis, n'en doutent pas un instant. Puis Dick vire de bord, jure son Grand Dieu qu'il n'a jamais rien pris de tel. Pourtant, l'époque, le lieu, et ses fréquentations qu'il qualifie lui-même de douteuses, le donnent fortement à penser. Des scènes entières de plusieurs de ses romans ainsi Ubik, Au bout du labyrinthe,(32) le Dieu venu du Centaure, et de ses nouvelles comme "la Foi de nos pères" semblent directement issues de trips plus ou moins heureux à l'acide. Mais il dépeint ces drogues sous les couleurs les plus noires comme des moyens de l'aliénation des masses imposée par les Puissants et finit par condamner leur usage et célébrer leur répression dans Substance mort.(33)
À la fin, la seule expérience, involontaire, d'hallucinations provoquée par une drogue que Dick reconnaissait était l'effet du penthotal qui lui avait été administré en 1974 comme anesthésiant en vue de l'extraction d'une dent de sagesse. J'ai un doute sur les propriétés hallucinogènes du penthotal même si les effets sont hautement individuels. Un anesthésiant général comme le ketalar (kétamine) utilisé au tiers de la dose normale provoque des hallucinations intéressantes et souvent angoissantes (j'en ai fait l'expérience sous contrôle médical). Après lui avoir attribué son épiphanie religieuse de février-mars 1974, Dick a du reste renoncé à cette explication sans doute trop réductrice à ses yeux.
Il faut bien dire qu'après la période d'enthousiasme à la Timothy Leary pour différentes drogues psychédéliques et en particulier le LSD et autres psilocybines des années 1950 à 1970, une chape de plomb retomba. À partir de 1966, le LSD fut interdit en Californie par un certain gouverneur Ronald Reagan si bien que les laboratoires Sandoz cessèrent de le distribuer gratuitement à des fins de recherche, et l'interdiction et la pénalisation de son usage et de sa commercialisation s'étendirent au monde entier avec la convention de l'ONU sur les substances psychotropes de 1971. Toute recherche cessa dès lors. Il est amusant de constater que le docteur Jean Thuillier, neuropsychiatre et pharmacologue, décrit encore en 1981 une cure réussie au LSD durant les années 1950.(34) On comprend mieux, toutefois, la réticence de Dick, quelque peu paranoïde (j'ai là-dessus aussi un doute, mais j'y reviendrai) et en tout cas méfiant, à s'exprimer sur ce sujet contrairement à une abondante cohorte d'écrivains, de musiciens et de penseurs qui lui furent contemporains.
L'histoire de l'interdiction du LSD ressemble beaucoup à un roman de Dick. Le produit étant actif à très faible dose, de l'ordre de cent microgrammes, et soluble dans l'eau, et bien qu'il ne provoque en principe pas d'assuétude ni d'addiction et que ses effets dangereux soient très mal documentés, la CIA, après s'y être beaucoup intéressée, obtint son interdiction absolue en 1967 sous le prétexte que des terroristes pouvaient en verser de petites quantités dans les réservoirs d'eau et provoquer des psychoses collectives incontrôlables. Il est plus vraisemblable que son usage massif par les tenants de la contre-culture américaine inquiéta les défenseurs de l'ordre et de la loi. Timothy Leary le paya de nombreuses années d'exil et de plusieurs années de prison, davantage pour ses propos et écrits que pour ses infractions. L'interdiction du LSD est d'autant plus surprenante que la toxine botulique, également soluble dans l'eau et létale à des doses bien plus faibles, de l'ordre de quelques nanogrammes, est librement commercialisée aux fins d'atténuer les rides des dames vieillissantes.
Si donc Dick a dénié ou plutôt renié tout usage de substances hallucinogènes, ses biographes ont montré moins de retenue. Sutin admet quelques expériences de son auteur au LSD. Marcel Thaon, qui connaissait bien Dick,(35) indique que celui-ci eut massivement recours aux amphétamines à la fois pour lutter contre la dépression et pour améliorer sa productivité, ce que confirme Sutin. Dick reconnaît une consommation industrielle tout en prétendant un temps qu'il ignorait que le médicament prescrit contenait des amphétamines, mais il préfère de beaucoup expliquer l'étrangeté de certains de ses écrits et comportements par un trait schizoïde ou carrément schizophrénique de sa personnalité. J'ai là-dessus un doute sérieux que je détaillerai plus tard.
Les menaces dont il aurait été l'objet de divers côtés à l'entendre fondent sa réputation paranoïde. En particulier, durant la majeure partie de sa vie, il se plaint d'avoir été l'objet de l'attention de la police, du FBI et de la CIA. Si, à en croire sa seconde épouse Kleo Apostolides, deux agents mineurs du FBI s'intéressèrent un temps à leurs fréquentations, sur un mode plus amical qu'inquisitoire, tout le reste semble relever de l'affabulation. Il subsiste un doute sur les agressions dont son domicile fut victime en novembre 1971 et en particulier sur la destruction, à l'explosif d'après lui, d'un véritable coffre-fort (trois cent cinquante kilos, dit-il) où il conservait ses papiers, manuscrits et sa collection de pulps. Il semble plutôt que l'armoire ait été forcée et l'enquête de police n'en découvrit jamais les auteurs, au point de finir par soupçonner Dick lui-même. Celui-ci multiplia évidemment les hypothèses, ne négligeant pas d'incriminer des agents fédéraux, FBI ou CIA,(36) ce qui paraît totalement invraisemblable. On ne voit pas pourquoi de telles agences se seraient intéressées un instant à un auteur de Science-Fiction encore très peu connu en dehors d'un cercle étroit et qui n'avait aucun passé ni criminel ni politique.
En revanche, on sait très bien d'une part que Dick avait un sérieux problème avec l'autorité quelle que soit sa forme, et plus peut-être encore qu'il lui fallait absolument se donner de l'importance en prétendant avoir attiré l'attention des puissances ténébreuses qui règnent sur ce monde. Certes, l'Amérique de 1971 est celle de Richard Nixon, mais l'appartement de Dick n'a pas grand-chose à voir avec le Watergate.
Dans la plupart de ses œuvres, Dick présente sous le pire jour les instances de pouvoir de toute nature, politiques, économiques voire religieuses. Ses romans et nouvelles font un large appel à des théories du complot, ce qui est au demeurant assez fréquent dans la Science-Fiction. Que sa fiction ait pu contaminer sa vie n'a rien de surprenant. Je reviendrai ultérieurement sur ce que cela peut signifier quant à sa personnalité profonde. Il y a chez lui comme une insistante revendication anarchisante et anti-collectiviste qui conduit à se demander si, comme certains de ses collègues, il n'a pas été libertarien. Il a certainement entendu parler d'Ayn Rand et il a peut-être lu son roman, la Grève.(37) Mais c'est pousser le bouchon un peu loin. Au surplus, Ayn Rand était violemment athée, ce qui ne lui aurait pas plu.
Mais voici la question majeure. Philip K. Dick est-il un grand écrivain ?
Certainement pas si l'on considère plusieurs aspects de son œuvre. Ce n'est pas un styliste : son vocabulaire est pauvre si l'on néglige ses remarquables néologismes, ses dialogues souvent plats et strictement fonctionnels ; la construction de ses romans et nouvelles ne présente guère d'originalité en dehors d'une tendance certaine à la dérive qui frise parfois l'incohérence. Il ne peut à aucun moment se réclamer d'une avant-garde, comme ses contemporains de la Beat Generation, William S. Burroughs, Allen Ginsburg et Jack Kerouac, ou se targuer d'avoir inventé, comme eux, de nouvelles formes.
Dick est l'écrivain le plus inégal que j'aie jamais rencontré. Tout éditeur sait qu'un auteur dispose d'une gamme qualitative assez étroite. Un écrivain médiocre, hors maladresses des débuts, ne donnera jamais un chef-d'œuvre. Inversement, un écrivain doué ne parviendra généralement pas à produire un texte alimentaire simpliste même si sa santé financière en dépend. Contrairement à ce qu'il pensait, Jacques Laurent ne se distingue pas vraiment de Cécil Saint-Laurent. Philip K. Dick dément absolument cette règle empirique. Il est capable du pire comme du meilleur. Il est compréhensible que ses premiers romans de Science-Fiction soient moins aboutis que les suivants, mais cette inégalité perdure comme le confirme Lawrence Sutin qui note ses œuvres de 1 à 10.(38) Certes Dick plaçait ses espoirs dans le roman “réaliste” et il a sans doute négligé au départ ce qu'il considérait comme un genre secondaire. Serait-ce précisément la Science-Fiction qui interdirait, dans la tradition des pulps, une certaine recherche littéraire ? Ray Bradbury, Kurt Vonnegut, Jr., peut-être Alfred Bester, qui sont ses contemporains, et plus tard Thomas M. Disch, qui fut un ami et admirateur de Dick, et Gene Wolfe (dans certaines de ses œuvres), démontrent le contraire.
La vitesse à laquelle écrit Dick est une explication partielle de certaines négligences et incohérences. Son ami et conseiller littéraire John Gildersleeve, qui trouvait que son talent avait quelque chose d'inconstant, déclare : « Il faisait du quatre-vingts ou cent mots minute ! Il inventait l'histoire à mesure qu'il frappait les touches et allait tellement vite qu'il était constamment obligé, selon le cas, de taper aussi vite qu'il pensait ou bien de penser aussi vite qu'il tapait. »
.(39) Et Dick de confirmer : « C'est de mes doigts que sortent les mots, et non de ma tête. »
. Il faut ajouter qu'il se relisait et se corrigeait peu, sauf pour ses romans “réalistes”.
Ensuite, Dick n'a pas rencontré d'emblée d'éditeur qui l'encadre, à supposer qu'il l'ait accepté. Deux éditeurs l'ont beaucoup et durablement aidé à ses débuts. Anthony Boucher, le plus exigeant littérairement, dirigeait Galaxy mais il avait l'habitude de retoucher les textes qu'il publiait, ce qui déplaisait à Dick. Le second, Donald A. Wollheim que j'ai bien connu, était une personnalité de la Science-Fiction américaine. Lecteur et fan de la première heure, organisateur d'une convention à Philadelphie en 1936 qui réunit quelque neuf membres et qui serait la première du genre, puis participant à la première Convention mondiale de Science-Fiction de 1939(40) qui en aurait réuni deux cents, auteur plutôt médiocre, homme chaleureux et à sa manière généreux, il reconnut très tôt le talent de Dick et publia ses vingt premiers romans en sa qualité de directeur littéraire d'Ace Books puis de DAW Books. Sutin commet parfois des omissions surprenantes : ainsi il indique que, durant les années 1950, seuls les éditeurs de poche Ace et Ballantine publièrent des romans de Science-Fiction.(41) Sans entrer dans le détail, au moins quatre autres éditeurs également de poche, Dell, Signet, Bantam et Pyramid proposèrent à cette époque des romans signés d'A.E. van Vogt et de Theodore Sturgeon par exemple. Ils n'éditèrent pas Dick, mais peut-être seulement parce que Wollheim s'était réservé sa production et qu'il “râla” quand Dick réserva ses meilleures nouvelles à un recueil qui devait paraître plus tard chez Ballantine.(42) Ace Books publiait une collection de poche populaire sans prétention intellectuelle(43) qui s'établissait dans la tradition des pulps, en particulier par ses illustrations de couverture. Une de leurs spécialités fut les Ace Double Novel Books qui réunissaient tête-bêche deux romans, généralement d'auteurs différents. Le premier recueil de nouvelles de Dick, que j'ai sous les yeux, échappa à ce sort. Pendant au moins dix années, Dick vécut de ces publications et, semble-t-il, le déplora et en eut même honte. Mais si Wollheim sut l'encourager, le soutenir financièrement (avec sobriété) et certainement le conseiller,(44) il n'était ni Gaston Gallimard ni Jérôme Lindon et il n'a sans doute pas poussé Dick dans la voie de la sophistication. Dick lui échappa dès que son agent put lui ouvrir les portes de Putnam et de Doubleday, autrement réputés.
Cette digression sur le principal éditeur de Dick à ses débuts, sans lequel il n'aurait certainement pas pu persévérer, souligne un problème économique récurrent. Même s'il a vécu confortablement dès le milieu des années 1960, il n'a vraiment gagné sa vie (et la liberté d'écrire ce qui lui aurait plu)(45) qu'après sa mort certes survenue tôt.(46) Si un circuit financier trans-temporel avait pu financer le jeune Dick, il aurait peut-être écrit autre chose et mieux. Un éditeur qui pressent un talent devrait pouvoir investir à long terme. Le temps court de l'édition populaire de poche ne le permettait pas à un homme comme Wollheim, si bien disposé qu'il fût. Et la durée de plus en plus brève des contrats l'interdit et favorise la publication de best-sellers à la rentabilité rapide et rarement pérenne.
Cependant Dick est un immense auteur. Le découvrir et le relire est une expérience inoubliable. Son sens de l'humour et sa capacité à faire coexister humour et horreur dans une exquise absurdité me font penser à Franz Kafka. Celui-ci passait, selon son ami et inexécuteur testamentaire Max Brod, pour hurler de rire quand il lisait à haute voix ses propres textes. En France, l'interprétation horrifique des textes de Kafka, qui est probablement un contresens, a prévalu. Chez l'un et chez l'autre, il ne s'agit pas de l'humour noir cher aux surréalistes, qui est une prise de distance, une ironie, mais bien d'un humour pur et d'une horreur pure juxtaposés.
Dick et Kafka ont aussi la même dimension prophétique. J'ignore si Dick a jamais lu Kafka mais le contraire m'étonnerait au vu de sa boulimie de lectures et de son intérêt pour la langue allemande. Il y a un lien subtil entre l'Amérique, premier roman inachevé de Kafka, et les œuvres “réalistes” de Dick, dans la colère sourde que suscitent en eux la disparition du “petit homme” et la dénonciation de l'absurdité d'un monde social jusque dans le titre originellement voulu par Kafka, der Verschollene, rendu désormais en français par le Disparu mais qui le serait mieux par l'Évanoui. Ce qui sonne plus dickien.
On m'objectera que Kafka est un orfèvre de la langue allemande tandis que Dick est un écrivain assez limité. Mais virtuosité et originalité ne vont pas nécessairement de pair : si l'on considère Franz Liszt et Érik Satie,(47) le second a sans doute plus ébranlé la musique que le premier.
Un autre aspect qui fait de Dick un immense auteur tient à sa capacité d'analyse et de prospective sociétales. Si l'on fait abstraction de la quincaille propre à la Science-Fiction (astronef, colonies sur Mars, voyages interplanétaires), que méprisait Dick sans s'en priver, ses mondes pessimistes reflètent bien la réalité sociale de la fin du xxe siècle et du début du xxie : sociétés stagnantes, prolétariat épuisé et désabusé placé sous l'emprise d'illusions, monopoles dominant l'économie et la politique. Des inégalités sociales monstrueuses confinent à la métaphysique. La paranoïa prêtée à Dick s'est étendue à la société entière. Les ultra-riches ont recours à des sociétés de protection de leurs secrets et de leurs personnes comme celles qu'il met en scène. Des agences privées de renseignement les informent, très semblables à celle de Runciter,(48) sans avoir toutefois recours à des mutants. Dick peint un tableau assez juste de l'Amérique de son temps mais plus encore de l'avenir. C'est cet aspect de son œuvre que j'abordais en 1969 dans un article, "Philip K. Dick ou l'Amérique schizophrène", négligeant sa psychologie dont j'ignorais tout et qui devait être explorée par Marcel Thaon. C'est celui aussi qui lui valut un peu plus tard le respect et l'attention d'éminents critiques néo-marxistes, Darko Suvin, Peter Fitting et Fredric Jameson, entre autres, dans les pages de la revue de référence, Science fiction studies, et ceux de John Brunner et de Brian W. Aldiss. Le monde chargé d'illusions imaginé par Dick préfigure celui dénoncé par Jean Baudrillard : « Disneyland est posé comme imaginaire afin de faire croire que le reste est réel, alors que tout Los Angeles et l'Amérique qui l'entoure ne sont déjà plus réels, mais de l'ordre de l'hyperréel et de la simulation. Il ne s'agit plus d'une représentation fausse de la réalité (l'idéologie), il s'agit de cacher que le réel n'est plus le réel, et donc de sauver le principe de réalité. »
.(49)
Dans cette perspective, là où Dick se révèle le plus (extra)lucide dans sa proclamation du peu de crédibilité de l'apparence dans la cité des illusions, c'est à propos de l'univers informatique (qu'il n'a pas pu connaître) où nous baignons, où tout peut être mercantilisé (comme dans Ubik), retouché, déformé, truqué, images, sons, films. Un univers qui se trouve en phase avec le relativisme postmoderne : tout est équivalent, tout point de vue, toute opinion, jusqu'à l'incohérence de l'internet. Tout peut être trompeur. Plus rien n'est vrai même si tout n'est pas faux. C'est là que Dick devient un prophète involontaire, inconscient de l'être, ce qui n'aurait pas été pour lui déplaire. Le mutant précog (pour précognitif), figure récurrente de ses œuvres, est une métaphore de l'écrivain, tout spécialement de Science-Fiction, qui a l'intuition floue, diffuse, des problèmes de son groupe social et de son avenir. Son destin est souvent sinistre.(50)
L'écrivain français d'aujourd'hui le plus proche de Dick dans cette attitude ironique et critique serait encore Michel Houellebecq.
Une autre incertitude voisine qui hante Dick et que les marxiens rattacheront à l'aliénation du prolétaire dans une société où il n'est plus qu'un moyen de production, tient à la réponse à la question : qu'est-ce que l'humain ? Pour Dick, souvent, il n'est qu'un simulacre, un faux-semblant, un androïde, une machine, la fourmi électrique de la nouvelle du même nom(51) animée par un ruban perforé. Comment savoir ? C'est une forme singulière de solipsisme que d'en venir à penser qu'on est le seul être conscient et doté de libre arbitre dans un monde de machines.
Mais il y a plus étrange. Dans l'un de ses meilleurs romans, le Maître du Haut Château, son unique prix Hugo qui marqua le vrai démarrage de sa carrière, Dick ne se contente pas de proposer une uchronie. Il ne décrit pas une autre Histoire mais introduit à une infinité de lignes d'univers dont aucune n'est plus réelle que toutes les autres. L'incertitude ne porte pas sur la représentation du réel mais sur le réel lui-même. Déjà, dans un roman plus ancien, l'Œil dans le ciel, il avait imaginé l'exploration d'une succession d'univers alternatifs et subjectifs sur fonds idéologiques et il pose la question qui ne le lâchera jamais : qu'est-ce qui est réel ? À la suite d'un accident dans un “bévatron”, un groupe de visiteurs se trouve projeté successivement dans les univers idéaux et monstrueux de chacun d'entre eux, leur problème étant de regagner la réalité commune, à supposer qu'elle existe. Ce roman, le plus étonnant peut-être du jeune Dick, m'avait frappé au point que j'entrepris de le traduire et de le faire paraître sous un titre infidèle mais explicite : les Mondes divergents. Mais le plus étrange n'est pas là. Eye in the sky paraît chez Ace en 1957. C'est l'année où Hugh Everett (1930-1982), qui a passé sa thèse de doctorat de physique en 1956, publie un article où il défend une interprétation de l'effondrement de la fonction d'onde de Schrödinger au moment de la mesure, fondée sur sa théorie des mondes multiples, en fait des mondes divergents. Lorsque la mesure ne retient qu'un possible entre tous ceux contenus dans la fonction d'onde, Everett propose que tous les autres se réalisent également mais dans d'autres univers. Everett a-t-il eu connaissance du manuscrit de Dick, ou inversement ? Chose encore plus curieuse, Dick écrit son roman en 1955 et c'est cette même année qu'Everett rédige un manuscrit complet sur sa théorie, qui ne sera publié que plus tard. Singulier parallélisme entre deux univers strictement parallèles, aux deux bouts de l'Amérique, l'un situé à Princeton, dans le New Jersey, et l'autre à Los Angeles, en Californie. Bref le littéraire sans grande culture scientifique et le physicien qui lisait Astounding science fiction ne partagent guère de points communs, sauf leurs étranges idées métaphysiques sur la multiplicité des mondes et l'année de leur mort. Un Jungien y verrait de la synchronicité.(52)
Ces paradoxes et ces incertitudes, peut-on les éclairer en se penchant sur la structure psychologique de Dick, pour ne pas dire sa pathologie ? (J'y reviendrai dans une prochaine préface.)(53)
Ce premier recueil réunit six de ses romans de Science-Fiction des années 1953 à 1959, Loterie solaire,(54) les Chaînes de l'avenir,(55) le Profanateur,(56) les Pantins cosmiques,(57) l'Œil dans le ciel et le Temps désarticulé.(58) Pour être tout à fait franc, ce ne sont pas ses meilleurs, et il les écrit par dépit de voir refusés ses romans “réalistes”, mais l'on voit une œuvre s'y constituer, et trois d'entre eux au moins sont remarquables. Loterie solaire témoigne de l'influence d'A.E. van Vogt. Accessoirement, il introduit un thème assez rare, celui du pouvoir attribué par le hasard. Bien que je n'aie pas lu à l'époque ce roman, je développais la même idée mais dans un contexte différent dans le Sceptre du hasard, écrit en novembre 1963 et qui ne parut qu'en juin 1968 au Fleuve noir. L'Œil dans le ciel fut, comme je l'ai rapporté, son premier roman traduit par mes soins en français et publié d'abord dans "les Cahiers de la Science-Fiction" en supplément à la revue Satellite en 1959 sous le titre les Mondes divergents. Le Temps désarticulé est presque un roman réaliste, satire de son temps, mais où la réalité se fissure comme elle ne cessera plus de le faire dans sa vie et dans son œuvre.
Philip K. Dick n'aimait pas son Amérique, et celle de Richard Nixon, qui lui avait refusé le succès littéraire hors Science-Fiction, et pendant assez longtemps les moyens de vivre décemment tout en le persécutant, du moins le pensait-il. Il en a donc dressé des portraits peu flatteurs dans ses romans réalistes, parfois comparés à ceux de Charles Bukowski, et plus noirs encore dans ses œuvres de Science-Fiction où il critique avec véhémence et sous divers aspects le côté intolérant, policier, voire totalitaire, d'une Amérique héritière du sénateur McCarthy. Cette critique, excessive quoique non dépourvue de pertinence, lui a valu l'intérêt de néo-marxistes tant nord-américains que français, ce qui ne l'empêcha pas pour autant de dénoncer ces derniers au FBI lorsqu'ils vinrent solennellement lui rendre visite, tant était grande sa crainte de passer pour un activiste.(59)
Pourtant, il ne pouvait vivre ailleurs que dans la région de Los Angeles au point de renoncer à rejoindre dans le nord de la Californie, à Somoza, Joan, l'une des dernières femmes de sa vie.
C'est en France, pays qu'il a beaucoup idéalisé, qu'il reçut le meilleur accueil, éditorial, critique, financier et finalement d'hospitalité puisqu'il fut l'indiscutable vedette du festival de Metz en 1977. Mais, et la question mérite d'être posée, aurait-il pu, étant ce qu'il était et à supposer qu'il eût été français dans un de ses mondes parallèles, y vivre et y prospérer ? Je crains que non. S'il bénéficia en France durant la fin des années 1960, puis au fil des décennies 1970 et 1980 du succès grandissant de la Science-Fiction, et tout spécialement de ses formes déjantées et politiquement frondeuses, je ne crois pas qu'il aurait pu y vivre de sa plume et moins encore que sa personnalité excentrique eût été tolérée par les institutions. Si ses droits d'auteur français lui furent comme les droits anglais, japonais, italiens et allemands, un utile appoint de revenus, ils ne lui auraient pas suffi dans notre pays et il aurait perdu presque toute chance d'être traduit ailleurs. Ses écarts, à peine remarqués en Californie où l'originalité est de bon ton, l'auraient infailliblement conduit ici en hôpital psychiatrique, probablement pour longtemps. La France adore les génies extravagants pourvu qu'ils se tiennent à leur place. Demandez à Antonin Artaud.
Et puisqu'on parle de la France, il faut rendre hommage à ceux qui l'ont ici édité, traduit, anthologisé, commenté, parfois visité, invité, Alain Dorémieux, Michel Demuth, Marcel Thaon, Jacques Chambon, peut-être surtout à Hélène Collon, gardienne du temple Dickien qui a veillé au respect des textes, et enfin à Philippe Hupp qui, l'invitant au Festival international de Science-Fiction de Metz, nous a permis de le rencontrer.
Difficile enfin de ne pas penser, à propos de sa gémellité, à Judith Scott (1943-2005), sourde, muette et atteinte du syndrome de Down, qui créa une œuvre singulière et puissante, enveloppant des objets sous des enchevêtrements de fils, selon une logique obsessionnelle, et que sa sœur jumelle Joyce encouragea et fit connaître. Lorsque je découvris cette œuvre au collège des Bernardins, en novembre 2011, il me fut impossible de ne pas évoquer Jane.
- Hélène Collon (anthologiste) : le Kalédickoscope : regards sur Philip K. Dick (Encrage, 1992, deuxième édition revue et augmentée en 2006), ouvrage absolument indispensable qui complète la biographie de Lawrence Sutin. La discrétion de l'anthologiste et traductrice est telle qu'elle n'a même pas introduit son excellent choix de textes et d'entretiens et qu'elle feint de ne se manifester que dans quelques notes.
- Fredric Jameson : Penser avec la Science-Fiction (Max Milo, 2008).
- Kim Stanley Robinson : les Romans de Philip K. Dick (les Moutons électriques, 2005).
- Marcel Thaon : "Philip K. Dick : le roman familial psychotique", dans Science-Fiction et psychanalyse (Dunod, 1986).
Et (avec réserves) Emmanuel Carrère : Je suis vivant et vous êtes morts (le Seuil, 1993), roman.
- Cité par Lawrence Sutin dans Invasions divines (Divine invasions, 1989), biographie indispensable à tout dickien sérieux. En français chez Denoël en 1995. Édition de référence : Gallimard › Folio Science-Fiction, nº 88, 2002, p. 36.↑
- J'insistai auprès de Georges Belmont pour qu'il soit publié chez Laffont dans la collection "Pavillons", traduit par Janine Hérisson, dès 1978, sous le titre Confessions d'un barjo. J'ai lu en proposera une nouvelle traduction par Nathalie Mège en 2013.↑
- Vers une contre-culture (the Making of a counter culture, 1969).↑
- Do androids dream of electric sheep?, 1967, 1968, 1976. La première date est celle de la rédaction, la deuxième celle de la première publication américaine et la troisième celle de la parution française.↑
- Blade runner: a movie (1979, en français : le Porte-lame) fut le titre d'un synopsis de Burroughs inspiré du roman d'Alan E. Nourse, the Bladerunner (1974), titre qui fut racheté par Ridley Scott pour son film adapté du roman de Dick, par ailleurs sans rapport avec les textes précédents.↑
- Brian W. Aldiss et John Brunner ont beaucoup contribué à le faire connaître au Royaume-Uni.↑
- Il est piquant de constater que le premier adjectif littéraire auquel le nom de Poe est associé dans l'article américain de Wikipedia, par ailleurs excellent, est celui de Gothic qui renvoie à une tradition dite populaire.↑
- Au moins pour le moment, puisqu'il serait question d'une adaptation d'Ubik. Depuis 2008…↑
- "Postmodernism and the birth of the author in Philip K. Dick's Valis" de Christopher Palmer dans Science fiction studies, #55, November 1991 ; the Postmodern humanism of Philip K. Dick de Jason P. Vest (Scarecrow, 2009) ; voir aussi le site de Cal Godot, Postmodern angst, entre autres.↑
- Même titre original, 1966, 1969, 1970.↑
- le Dieu venu du Centaure (the Three stigmata of Palmer Eldritch, 1964, 1965, 1969).↑
- On pourrait sans effort le faire remonter beaucoup plus haut à Marcel Duchamp.↑
- Exposé à la FIAC 2011 et reproduit dans le Libération du 20 octobre 2011.↑
- ""Postmodernism or the Cultural logic of late capitalism"", article de 1984 repris dans l'ouvrage de même titre (Duke University, 1991). Cité par Philippe Dagen dans "Comprendre le modernisme", à propos d'une exposition à Londres, dans le Monde du 18 octobre 2011, p. 27.↑
- Ce disant, il exagérait peut-être, ce qui était une façon de se singulariser. Dénier la réflexion sous-jacente est bien dans la veine du postmodernisme.↑
- Requiem pour le postmoderne, excellent dossier du Courrier international, nº 1092, du 6 au 12 octobre 2011. Lire en particulier l'article du Guardian à propos de l'exposition précitée.↑
- the Man in the High Castle, 1961, 1962, 1970.↑
- Sur l'opposition irréductible entre Science-Fiction et Fantasy, lire les chapitres VI et suivants d'Archéologies du futur : le désir nommé utopie de Fredric Jameson (Archeologies of the future: the desire called utopia and other science fictions, 2005), en français chez Max Milo.↑
- Sutin, p. 347 et suivantes.↑
- Philippe Curval a plusieurs fois situé la Science-Fiction dans la lignée du surréalisme et de la démarche d'André Breton.↑
- Ainsi dans sa nouvelle "la Foi de nos pères" ("Faith of our fathers", 1966, 1967, 1969).↑
- Mais pas toujours. La position de Dick sur de telles drogues est pour le moins ambiguë. J'y reviendrai.↑
- Ainsi dans les Clans de la Lune Alphane (Clans of the Alphane Moon, 1964, 1964, 1973).↑
- Sutin, p. 31.↑
- Voir la préface du Livre d'or de Philip K. Dick, réuni et préfacé par Marcel Thaon (Presses Pocket, 1979).↑
- Sutin, p. 43 et 44. Lire aussi la suite.↑
- Sutin, p. 40.↑
- Sutin, p. 41.↑
- Alain Dorémieux était peut-être là, en tant que traducteur, admirateur et anthologiste de Dick mais je n'en suis pas certain.↑
- Celui-ci a été plusieurs fois reproduit, notamment dans le recueil de quatre essais et conférences de Dick, Si ce monde vous déplaît… et autres écrits (l'Éclat, 1998).↑
- Sutin, p. 194-195.↑
- a Maze of death, 1968, 1970, 1972.↑
- a Scanner darkly, 1973, 1977, 1978.↑
- Dans la Folie : histoire et dictionnaire (Robert Laffont › Bouquins, 1996), p. 165 et suivantes.↑
- Je crois me souvenir que Thaon rendit visite à Dick en Californie mais je n'en suis pas absolument certain [Cette visite, qu'il a qualifiée de très angoissante, a été contée à Quarante-Deux par Marcel Thaon vers la fin des années 80].↑
- Sutin, p. 405 et suivantes.↑
- Atlas shrugged, 1957.↑
- Sutin admire l'œuvre de Dick de façon sélective mais il accorde une certaine préférence à ses romans “réalistes”. Je le soupçonne de connaître assez mal la littérature de Science-Fiction et de la tenir en piètre estime.↑
- Sutin, p. 204.↑
- Wollheim ne prenait pas le qualificatif “mondial” à la légère. Se souvenant de ses origines scandinaves, il fut l'un des très rares éditeurs américains à publier des auteurs européens et notamment des Français dont je fus. Dans des traductions épouvantables.↑
- Sutin, p. 206-207.↑
- Ce Best of parut en fait en 1977 chez Del Rey, division de Ballantine.↑
- Par bien des côtés, elle ressemble à la collection "Anticipation" du Fleuve noir qui lui est à peu près contemporaine.↑
- Dick bénéficia aussi des conseils de l'agence Scott Meredith avec laquelle il eut parfois des relations tumultueuses mais qui lui fut d'une grande aide.↑
- Pas nécessairement ce que nous préférons.↑
- Difficile ici de ne pas penser à Boris Vian, traducteur entre autres activités de Van Vogt, qui devint riche à titre posthume.↑
- La vie sentimentale de Satie fut moins riche mais aussi sombre que celle de Dick. Il y a beaucoup d'autres parentés entre leurs œuvres et leurs vies. Et si cette citation de Google ne vous fait pas penser à Dick, je ne peux plus rien pour vous :
« Pour augmenter votre productivité, Satie a conçu Proclip, le châssis d'armoire électrique par clipsage qui répond à tous vos besoins. »
…↑ - Dans Ubik.↑
- Simulacres et simulation, 1981.↑
- Le Prophète de Dune (1963-1965) de Frank Herbert lui est à peu près contemporain mais sur le mode épique alors que le précog dickien demeure un médiocre ou devient une victime ordinaire.↑
- "the Electric ant", 1969.↑
- J'évoque à nouveau le cas Everett dans ma préface au troisième recueil, Romans 1963-1964.↑
- Celle du recueil suivant, Romans 1960-1963.↑
- Solar lottery, 1954, 1955, 1968.↑
- the World Jones made, 1954, 1956, 1976.↑
- the Man who japed, 1955, 1956, 1977.↑
- the Cosmic puppets, 1953, 1956, 1984.↑
- Time out of joint, 1958, 1959, 1975.↑
- Sutin, p. 495.↑

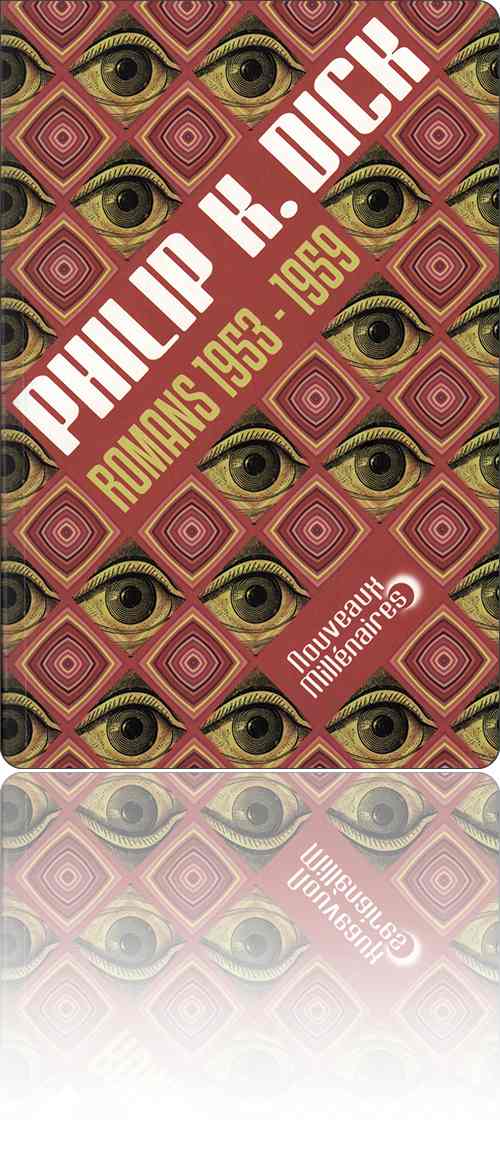
/Loterie_solaire_(2013).i.jpg)
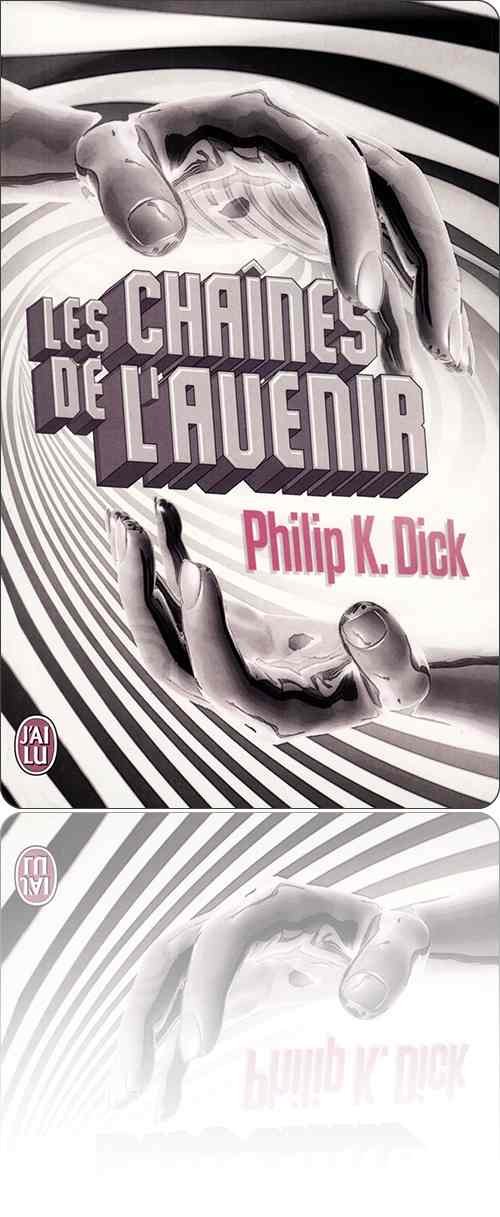
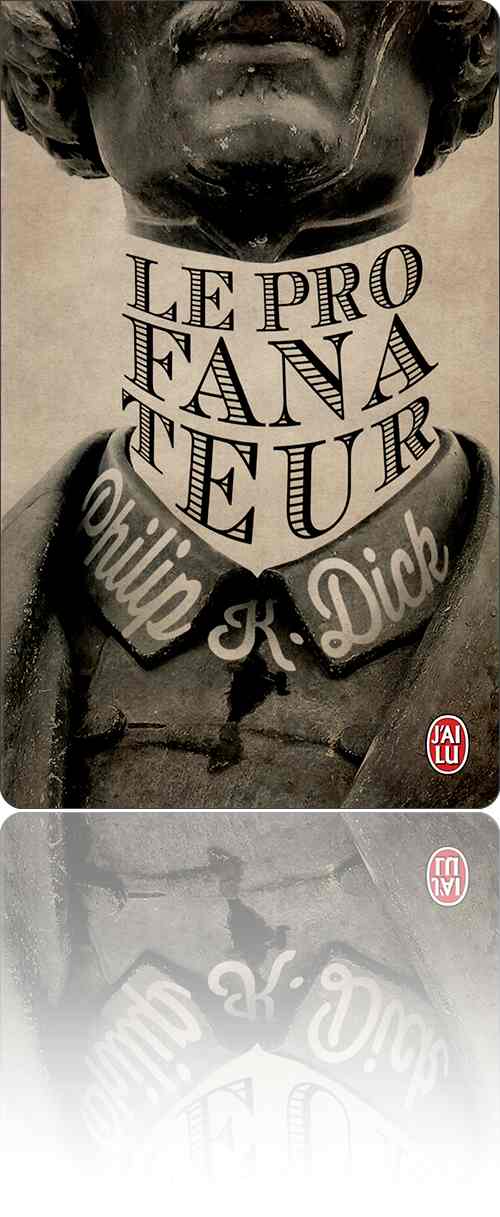
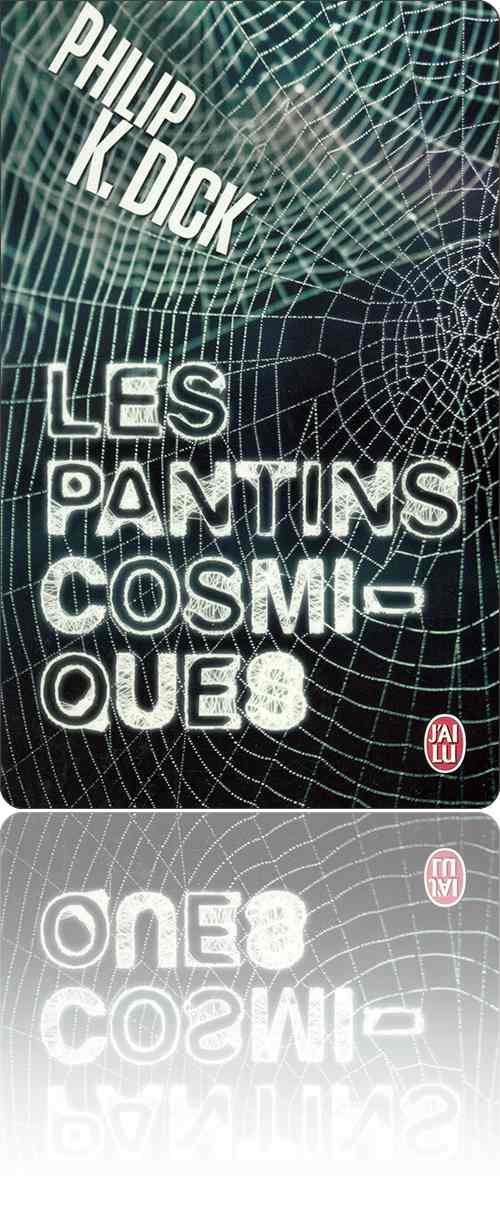
/l%27Oeil_dans_le_ciel_(2014).i.jpg)
/le_Temps_desarticule_(2014).i.jpg)