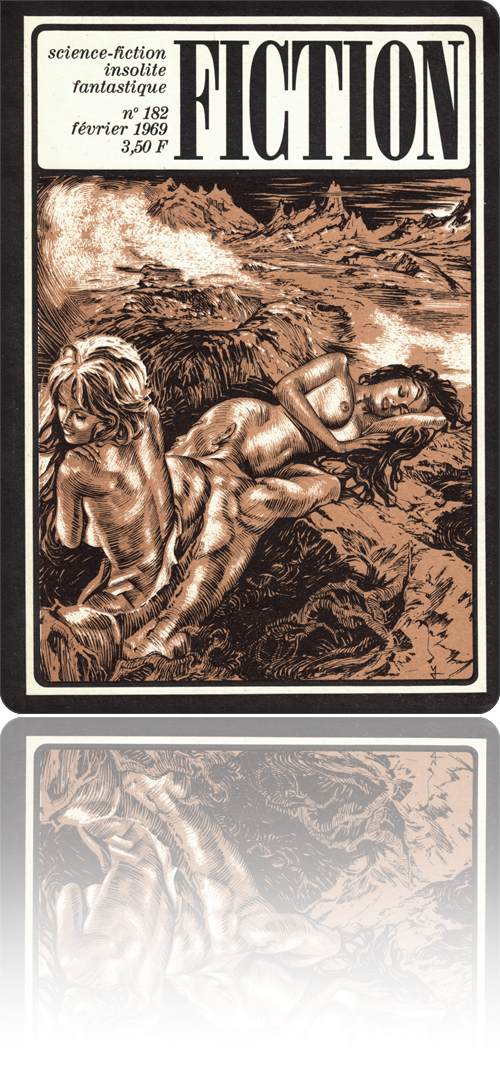Philip K. Dick ou l'Amérique schizophrène
au sommaire de la revue Fiction, 1969
- par ailleurs :
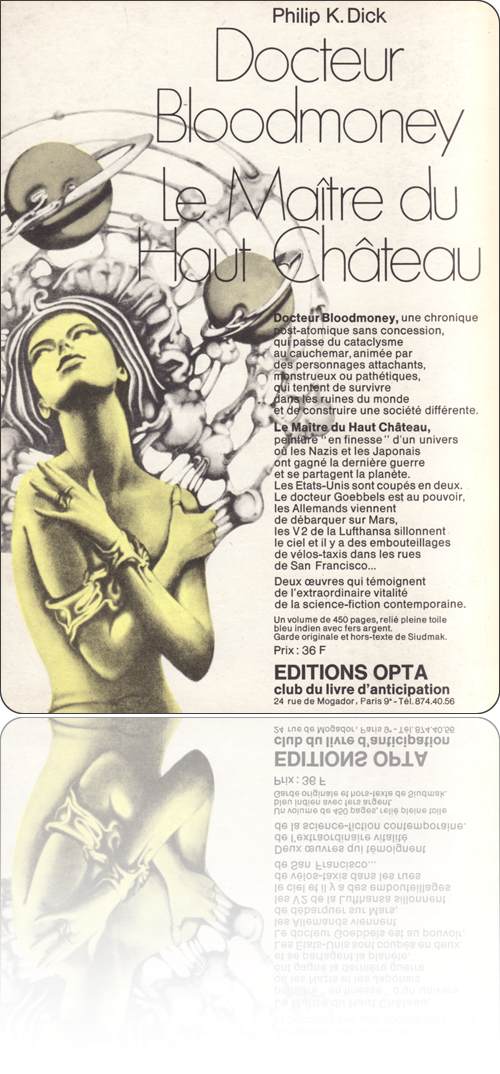
Né en 1928 à Chicago, Philip K. Dick a traversé très jeune le continent américain et s'est fixé sur la côte ouest en Californie. Il vit près de Los Angeles, il est marié, il aime la musique et les chats. Il reconnaît s'être livré ces dernières années à de nombreuses expériences avec les drogues dites psychédéliques. On verra que ces expériences ont un sens par rapport à son œuvre. Il a commencé à publier en 1952 et s'est tout de suite avéré un auteur original et fécond. Son premier roman, Loterie solaire, paraît en 1955. Il obtient en 1963, pour son livre le Maître du Haut Château,(1) la plus haute distinction de la Science-Fiction, le prix Hugo. Il a écrit à ce jour une centaine de nouvelles et vingt-cinq romans.
Voilà à peu près tout ce que j'ai pu apprendre sur Dick en consultant les jaquettes des ouvrages qu'il a publiés et les quelques articles écrits sur son compte. Fort peu de chose. Cette discrétion peut paraître paradoxale quand on sait le culte qui entoure bien vite un auteur de Science-Fiction, outre-Atlantique, et la diversité des exégèses à laquelle son œuvre donne lieu.
Ce relatif silence ne résulte pourtant pas d'un oubli. Il est significatif de la carrière de Dick, auteur prolifique mais assez peu connu jusqu'en 1963. Tout le monde avait lu, certes, de ses nouvelles, car il a été par la dimension de sa production l'un des écrivains les plus éclectiques dans le choix de leurs supports. Mais personne ne se souvenait de son nom. Il est caractéristique que la même mésaventure lui soit arrivée en France. Si l'on excepte la publication des Mondes divergents dans la collection "les Cahiers de la Science-Fiction" en supplément à Satellite et l'accueil fait à sa nouvelle "le Père truqué", reproduite quatre fois dans notre pays, il était demeuré jusqu'à la récente offensive des éditions Opta à peu près inaperçu. Inaperçu et non proprement inconnu puisque les lecteurs de Galaxie et de Fiction ont eu souvent à lire de ses œuvres et les ont appréciées. Aucune des grandes collections ne l'avait accueilli. Dans le dictionnaire des auteurs de son anthologie de l'épouvante, Jacques Sternberg le juge sévèrement : « Philip K. Dick n'est certainement pas un auteur de premier plan, même dans le strict domaine de la Science-Fiction… »
.
Dick n'en compte pas moins, et depuis longtemps, de fervents admirateurs qui le comparent à un Van Vogt ou à un Asimov. Je suis de ceux-là, et d'autant plus heureux de pouvoir lui rendre aujourd'hui un hommage que j'avais apprécié en son temps l'un de ses premiers romans : les Mondes divergents,(2) que je fis éditer et que je traduisis sans trop l'abîmer, j'espère. La question se pose cependant de savoir pourquoi son œuvre a mis tant d'années à être reconnue. J'y vois deux raisons. La première, qui concerne surtout le public américain mais qui explique sans doute qu'il n'ait pas trouvé place ni dans "le Rayon fantastique", ni dans "Présence du futur", est qu'il a publié la plupart de ses romans dans une collection populaire, les Ace Novels, qui malgré son intérêt croissant ne jouit pas d'un très grand prestige intellectuel. Elle correspond à peu près sur le marché américain au Fleuve noir en France. Elle joue d'ailleurs un rôle important qui est bien celui du Fleuve noir ici : celui d'une collection d'initiation. Mais, en même temps, elle accueille libéralement à côté des vieux routiers du space opera les débutants brillants : ainsi Philip K. Dick, Jack Vance, Harlan Ellison, Thomas M. Disch, Roger Zelazny et aussi Philip José Farmer qui fut, on l'a dit ici même, contraint à quelques nouveaux départs. Un autre facteur, moins circonstanciel, qui a sans doute conduit à sous-estimer le talent de Dick, est que celui-ci ne cherche pas à passer pour un grand styliste. Il écrit d'une manière concise, hachée, relativement neutre, presque transparente. Il est impossible de ne pas se souvenir de l'écriture d'un Bradbury de la bonne époque. Ce style particulier, aisément reconnaissable, donne un visage aux textes et force à retenir le nom de leur auteur. C'est ce qu'a compris Harlan Ellison, qui s'est fait une renommée un peu facile en torturant la langue. Par contre, quand on a lu une nouvelle ou un roman de Dick, on se souvient en général d'une idée, souvent fulgurante, mais non d'une prose. Une étude attentive du style de Dick donne même l'impression qu'il néglige les effets possibles, voire qu'il les gomme, comme s'il voulait éviter de détourner l'attention de l'essentiel, c'est-à-dire de l'idée et de la trame de l'œuvre. Au contraire de beaucoup d'écrivains de Science-Fiction comme Clifford D. Simak, A.E. Van Vogt à l'occasion, et évidemment Ray Bradbury, Dick n'est jamais un lyrique. Il n'a pas non plus le goût de l'épopée. Enfin, il ne se soucie pas, en général, quoiqu'il en soit capable à l'occasion, de donner à ses personnages beaucoup d'épaisseur psychologique, de vraisemblance. Il se contente de les dessiner à grands traits, sans négliger les détails stéréotypiques.
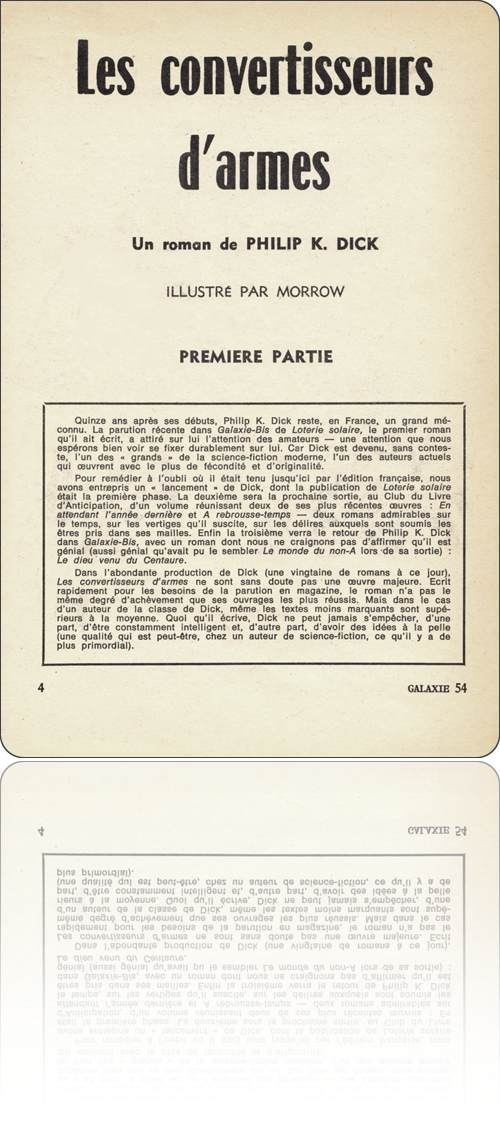
Ce qui intéresse au premier chef Dick, ce sont les structures plus ou moins labyrinthiques au sein desquelles se déploient ses héros et ce qu'ils contribuent à former par leurs relations entre eux. Ce sont, pour employer ses propres termes, les “univers”. Il en résulte un foisonnement extraordinaire de personnages qui peut dérouter le lecteur non prévenu. La dimension dans laquelle se développent les romans de Dick n'est pas, en effet, celle de la biographie d'un certain nombre de personnages comme dans le roman classique ou dans la plupart des romans de Science-Fiction, où les héros sont de ce fait peu nombreux : c'est au contraire celle de l'interaction des personnages et des autres prémisses — disons des idées. On pourrait aller jusqu'à dire que les véritables héros des romans de Dick sont les événements et non les individus. Il en découle que les personnages sont nombreux, interchangeables, sous certaines limites et qu'ils n'ont en principe pas plus d'importance les uns que les autres. Dans certaines œuvres comme les Convertisseurs d'armes (1965),(3) un personnage parfaitement épisodique se révèle détenir la clé du livre. Dans d'autres, il n'y a pas de héros central. Et là même où il en subsiste un, il apparaît bientôt que ni la structure de l'œuvre ni sa signification ne sont centrées sur lui. Le héros central auquel le lecteur est censé s'identifier subsiste seulement au titre d'une convention commode pour le lecteur non prévenu. Mais les romans et jusqu'aux nouvelles de Dick sont ainsi écrits qu'ils excluent pratiquement toute possibilité d'identification. C'est là sans doute une raison supplémentaire pour qu'un lecteur peu attentif les néglige ou les rejette parce qu'il leur applique des critères traditionnels : ceux du roman classique. Van Vogt a parlé quelque part de la possibilité d'écrire un roman non-aristotélicien, où aucun héros n'occuperait de situation privilégiée. Il est clair qu'il n'y est jamais arrivé si même il l'a tenté. Mais les œuvres de Dick sont certainement la forme de littérature la moins aristotélicienne en ce sens précis. Et si elles sont restées longtemps inaperçues, c'est qu'elles contenaient quelque chose qui ne pouvait pas être perçu du lecteur avant que de nouvelles valeurs culturelles se soient imposées de par leur présence même, ou plus simplement avant que le lecteur en ait pris l'habitude, que son œil se soit accommodé. Il est assez logique, l'accommodation faite, que le lecteur revienne avec intérêt sur des œuvres antérieures dont il n'avait pas, au départ, saisi toute l'originalité.
Il est intéressant de remarquer que cette tendance est précisément — en dehors de la Science-Fiction — celle des formes les plus avancées de la littérature contemporaine et en particulier du Nouveau Roman. J'ai pu montrer dans ces pages que le roman d'Alain Robbe-Grillet, la Maison de rendez-vous, avait une structure proche de celle d'un roman de Science-Fiction moderne et que les véritables “personnages” de cette œuvre faussement énigmatique étaient les événements et non les personnages humains. Afin de rendre ceci plus évident, Robbe-Grillet avait choisi, comme fait souvent Dick, de faire intervenir un temps peut-être cyclique, mais certainement non linéaire et non continu. L'hypothèse d'une influence réciproque paraissant pouvoir être rejetée, il faut bien admettre que Robbe-Grillet et Dick, dans des domaines et pour des lecteurs bien différents, sont arrivés, portés par le mouvement de la littérature et plus encore peut-être par celui de la société, à des solutions littéraires comparables encore qu'indépendantes. Ils ne sont certainement pas les seuls. Quelque chose se passe sous nos yeux qui est en train de faire émerger une nouvelle forme romanesque encore parée des oripeaux de l'ancienne. Et il ne nous est pas indifférent que la Science-Fiction, sous une forme apparemment très populaire, participe sans retard de ce mouvement, ou même le devance.
L'importance qu'il accorde aux événements, ou encore aux interactions entre les personnages considérés comme des particules élémentaires dotées de certaines caractéristiques, conduit Dick à user avec une grande virtuosité de tout l'arsenal des thèmes de la Science-Fiction. Mais au contraire de la plupart de ses confrères, il ne les développe pas pour eux-mêmes et pour leurs conséquences directes, comme l'a fait Isaac Asimov pour les robots par exemple, mais en fonction de leurs effets, de leurs interactions entre eux et avec les personnages. C'est à l'intérieur d'une structure qu'ils servent : celle de l'univers du roman, qu'ils prennent leur sens. De là vient que Dick paraît renouveler des thèmes apparemment usés, comme le voyage dans le temps, les mondes parallèles ou la télépathie, qu'il jongle avec eux, qu'il n'hésite pas à les accumuler et à les opposer. De là vient aussi le charme premier de ses œuvres : il rafraîchit le regard blasé du vieux lecteur de Science-Fiction. C'est que Dick est, en un sens, l'un des premiers écrivains — mais non le seul — à s'être installé totalement dans la Science-Fiction. Au contraire de ses prédécesseurs et nombre de ses contemporains, il ne cherche jamais à justifier une idée pourvu qu'elle s'intègre logiquement à la structure de l'œuvre. Il n'a pas besoin d'appuis extérieurs, de rationalisations empruntées à la science. Sa documentation, souvent abondante et solide, l'aide sans plus à définir les contours de l'univers du roman, ou le meuble, mais n'intervient jamais en tant que justification. Dick est de ce fait un des plus purs écrivains de Science-Fiction. On peut imaginer Asimov écrivant des romans sur les savants contemporains, Van Vogt écrivant des westerns ou des thrillers, Simak des romans sentimentaux, mais on ne voit vraiment pas ce que Dick aurait pu écrire en l'absence de Science-Fiction.
Cette virtuosité dans l'usage des idées a amené quelques commentateurs, comme l'excellent John Brunner, à considérer l'œuvre de Dick comme une série de variations extrêmement brillantes sur un ensemble de thèmes récurrents.(4) Cette œuvre serait donc éclectique, complexe, presque insaisissable dans sa diversité. Il ne fait pas de doute que ces thèmes existent et Brunner les a fort bien identifiés. Mais il ne suffit pas de s'y arrêter. Au-delà d'eux, l'œuvre de Dick manifeste une unité forte et nette autour d'un problème central que ces thèmes servent et illustrent.
Ce problème central est celui de la situation de certains groupes sociaux, par la suite dénommés ici les individus, dans la société américaine, et de l'aliénation que cette société leur fait subir ou, si l'on préfère, risque de leur faire subir si les traits que constate Dick — plutôt qu'il ne les dénonce — se développent. Cette préoccupation est constante d'un bout à l'autre de son œuvre actuelle. Pourtant, cette œuvre témoigne d'une double évolution.
D'une part, elle est caractérisée par un déplacement lent, mais manifeste, de l'origine de l'aliénation depuis les structures sociales elles-mêmes jusqu'aux structures physiques — et peut-être métaphysiques — de l'univers de l'œuvre. En d'autres termes, les personnages, d'abord conscients du fait que leur aliénation (le fait qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent) provient de l'organisation de la société où ils vivent, projettent progressivement, de roman en roman, cette aliénation sur l'image “objective” qu'ils se font de l'univers qu'ils habitent. En d'autres termes encore, ils en viennent à percevoir dans la réalité physique le désordre (spatial et temporel) qu'ils savaient encore, à un stade antérieur, résulter seulement de l'effet sur eux des structures sociales aliénantes. Cette évolution, à son origine près, ici explicite, n'est pas pour surprendre le psychologue : c'est très sensiblement celle de la schizophrénie, qui conduit à un retrait progressif de la personnalité dans un univers chimérique qu'elle finit par tenir pour seul réel. Elle est encore moins faite pour surprendre le sociologue qui la constate fréquemment dans l'histoire de groupes sociaux entiers, et qui est précisément à même de saisir ses origines sociales au-delà de son expression bientôt décalée par rapport à ces origines. Ce qui est remarquable dans le cas de Dick, c'est qu'il ait réussi à établir dans ces romans un pont entre l'aliénation psychologique et l'aliénation sociologique, au point qu'elles apparaissent confondues.

Il est très difficile de dire si l'évolution signalée, de la conscience de l'aliénation à l'aliénation de la conscience, est celle de Dick lui-même, ce qui ne laisserait pas d'être inquiétant, ou seulement celle de son œuvre qui reproduirait par sa nécessité interne un schéma sociologique classique. En d'autres termes, Dick explore-t-il de plus en plus profondément les abîmes de l'aliénation ou se laisse-t-il lui-même aliéner au point de croire dans une certaine mesure à la réalité de ses projections ? Le fait qu'il écrive de la Science-Fiction porte à retenir la solution la plus optimiste. Il élude d'ailleurs magistralement le problème dans la postface qu'il a donnée au volume du CLA réunissant En attendant l'année dernière et À rebrousse-temps.
D'autre part, l'œuvre manifeste une évolution dans la nature des solutions données au problème posé. Des solutions de type social ou même franchement politique proposées dans les premières œuvres, ainsi dans Loterie solaire ou dans les Mondes divergents, elle passe à des solutions métaphysiques dans le Maître du Haut Château ou le Dieu venu du Centaure. Cette évolution est d'ailleurs strictement liée à la progression de l'aliénation que l'on soulignait plus haut. Ayant perdu la conscience claire des origines de son aliénation, l'individu attend une solution de ses problèmes du ciel ou encore d'une révélation sur la nature de l'univers.
En résumé, Dick peint l'Amérique, une Amérique schizophrène, et ce qu'il croit ou craint être son avenir. Dans le capitalisme de monopoles qu'il décrit dans ses premiers ouvrages, l'individu a perdu toute liberté, toute valeur autre que marchande, toute “qualité”. Réduit à l'état d'objet, sauf dans quelques cas sur lesquels on reviendra plus loin, il garde un temps le sentiment de son aliénation. Puis, ne parvenant plus à croire en lui-même, en sa réalité, il s'enfonce dans la folie, le plus souvent dans la schizophrénie. Le temps et l'espace perdent leur sens pour lui puisqu'il n'est plus relié à eux, ni aux autres, par un système cohérent de valeurs. Et, par un retournement caractéristique, il en vient à croire que le temps et l'espace n'ont pas de sens par eux-mêmes, qu'ils sont rompus, désordonnés : il projette sur eux son absence de cohérence. Et enfin, il cherche en dehors de lui et en dehors de la société, puisqu'il n'a plus avec les autres de relations significatives, un principe de cohérence qui soit absolu et extérieur à l'univers matériel ou du moins exploré. Néanmoins, l'individu ne se rend pas sans combat et il arrive qu'il puise dans son aliénation même la force et les armes qui lui permettront de lutter contre les structures sociales aliénantes. Vue sous cet angle, l'œuvre de Dick apparaît comme celle, non pas d'un moraliste de l'Homme individuel, mais d'un moraliste de la société humaine, ou du moins d'une société particulière.
Il donne lui-même une caution à cette hypothèse qui ferait d'un problème sociologique le pivot de son œuvre :
« Il me semble que la tâche d'un écrivain de SF, qui est d'écrire sur le futur, est de soumettre à un examen rigoureux les objectifs, leitmotive, idées et tendances de sa propre société pour voir à quoi ressemblera le monde à venir si ces éléments se développent et deviennent dominants. Tout se passe comme si l'écrivain de SF, quand il remarque une toute petite graine dans le monde actuel, devait imaginer d'une manière ou d'une autre la croissance de cette graine : jusqu'où ira-t-elle ? » (extrait de la postface au volume du CLA)
Mais le fondement le plus sûr de cette hypothèse reste l'œuvre elle-même de Dick, que l'on va examiner maintenant dans ses grandes lignes.
Dans sa célèbre nouvelle "le Père truqué", parue en 1954, Dick pose le problème de la dépersonnalisation de l'individu, sous le prétexte d'une invasion d'extraterrestres. Il est significatif que cette aliénation absolue se déroule dans le cadre d'une banlieue aisée à l'américaine. Et il est caractéristique que ce soit un enfant, encore “sauvage”, proche du fond supposé de la nature humaine, peu intégré à la société, qui perçoive l'aliénation de son père et qui y remédie en tuant la créature qui a pris sa place ou plutôt que son père est devenu. L'enfant lui-même était menacé : dans le cocon de la “chose”, il y avait un “embryon” à son image. Du moins a-t-il su réagir à temps. Pourtant, Dick ne le cache pas, à quelques centaines de kilomètres de là, une autre “chose” est à l'œuvre et il y a peu de chances que l'espèce humaine échappe à l'aliénation.(5) Il est assez surprenant que le roman de Jack Finney, l'Invasion des profanateurs, qui a été porté à l'écran presque sous le même titre et qui traite du même sujet, ait été publié également en 1954 dans sa version magazine. Cette année 1954 est celle de l'apogée et de la chute brutale du sénateur McCarthy, désavoué par le Sénat. Ainsi ces deux textes et le film que le second a inspiré peuvent-ils avoir deux sens : l'un circonstanciel et lié à la “chasse aux sorcières” ; l'autre plus profond, plus universel, la dénonciation de la dépersonnalisation des individus qui est liée à un système économique et social et qui a précisément accompagné ou rendu possible cette “chasse aux sorcières”. Si ce deuxième sens n'existait pas, Dick n'aurait eu aucune raison de pousser son œuvre, inlassablement, dans la même direction.

Loterie solaire paraît en 1955. Et ici, d'emblée, ce sont les structures économiques et sociales qui sont désignées comme responsables de l'aliénation. Dans l'univers de ce roman, le pouvoir effectif est détenu par les maîtres des Collines, sorte de complexes économico-urbanistiques qui représentent des monopoles. L'individu est totalement inféodé aux maîtres des Collines, auxquels il prête un serment personnel et inviolable sous peine de mort. Un énorme prolétariat de travailleurs manuels n'a rigoureusement aucun droit. Ce qui peut paraître curieux dans cette structure, c'est que le pouvoir politique, opposable aux maîtres des Collines eux-mêmes, soit conféré par le hasard. Cette solution peut paraître paradoxale et on s'attendrait à ce que les maîtres des Collines ne l'admettent pas. En réalité, elle est la seule logique. En effet, les puissants détiennent des armes suffisantes pour que des guerres de type féodal soient, dans ce monde surpeuplé, impensables. Le hasard est la réponse à l'équilibre de la terreur, comme le souligne Dick lui-même en rappelant la théorie des jeux et le principe du Minimax qui ont fondé la stratégie de la dissuasion. La Bouteille (machine du hasard) choisit en fait presque toujours le Meneur de jeu parmi les dirigeants des Collines. En effet, ceux-ci disposent des cartes de chance de leurs serfs. L'assassinat légalisé du chef politique est la contrepartie du système du hasard : en faisant assassiner le détenteur du titre, les maîtres des Collines rendent obligatoire un nouveau tirage au sort et accroissent leurs chances d'être choisis.
Il n'est pas besoin d'être un observateur politique averti pour découvrir que cette structure est une transposition, certes extrapolée, de la situation américaine. Depuis plusieurs décennies, tous les présidents des États-Unis ont été choisis dans une caste extrêmement restreinte qui ne compte à peu près que des milliardaires (ou des généraux). Les élections elles-mêmes jouent le rôle de machine du hasard puisque leur résultat, qui tient à quelques centaines de milliers de voix sur celles de plusieurs dizaines de millions d'électeurs, est à peu près imprévisible et n'a donc, ex ante, guère de signification politique. Il est jusqu'à l'assassinat en 1963 de John Kennedy, milliardaire élu président de justesse, qui paraît, sans même tenir compte d'attentats ultérieurs, justifier la structure “imaginaire” proposée par Dick. Celui-ci n'a pas besoin de disposer de dons de voyance : l'assassinat politique tient depuis longtemps une place importante dans la vie publique américaine, place que l'on pourrait qualifier d'institutionnelle (au sens sociologique et non pas politique). Dick se souvenait peut-être simplement de la tentative d'assassinat perpétrée contre le président Truman, le 1er novembre 1950.
Qu'en est-il, dans cette structure, des classes moyennes composées de spécialistes ? Légalement, elles disposent d'une possibilité théorique d'accéder au pouvoir (la carte de la chance) mais cette possibilité a d'autant moins de chance de s'actualiser que les individus remettent leur carte au maître de leur Colline et qu'il n'est guère aisé de vivre en dehors d'elle. Ils sont utilisés comme des instruments et n'exercent aucun contrôle effectif sur leur destin. La situation de Ted Benteley est typique : licencié par sa Colline, il cherche à prêter serment au Meneur de Jeu, mais à peine l'a-t-il fait pour échapper au système corrompu des Collines qu'il y retombe. Son nouveau patron, Reese Verrick, vient en effet d'être destitué par la Bouteille et remplacé par un inconnu. Ainsi Benteley, qui a cru servir une institution, se retrouve, sans qu'il y puisse rien, le serf d'un puissant. La situation de la secrétaire de Verrick, Eleanor, n'est pas moins caractéristique de l'aliénation : télépathe naturelle, elle doit subir l'ablation de ses “antennes” pour pouvoir suivre, au demeurant par fidélité personnelle, son patron. En effet, les télépathes sont constitutionnellement au service du Directoire. Ainsi, tous les individus, à l'exception des puissants, sont-ils, d'une manière ou d'une autre, mutilés.
Dans une société où presque personne ne détient plus aucun pouvoir, même sur lui-même, comme le souligne Dick, « les Hommes cessèrent de croire qu'ils pouvaient contrôler leur environnement »
. Le hasard leur paraît être le seul maître et le seul sens de l'univers. La projection de l'aliénation sur la réalité est ici explicite et manifeste. On verra qu'il n'en est plus tout à fait de même dans le Maître du Haut Château. Il est donc normal que la superstition fleurisse et que chacun se couvre d'amulettes. Chacun, sauf précisément les puissants, les maîtres des Collines, comme Verrick, pour qui le monde n'est pas gouverné par le hasard mais par leur volonté, dans les limites de leur puissance.
Pourtant, les individus n'ont pas totalement abdiqué. Ils luttent, avec des dés pipés, et conservent la conscience de leur aliénation : Benteley s'exclame : « Que peut-on faire dans une société qui est entièrement corrompue ? Obéir à des lois corrompues ? Est-ce un crime que de désobéir à une loi infâme ou à un serment vicié ? »
. La révolte de Benteley et aussi celle de Leon Cartwright, chef des Prestonites, apparaissent pourtant singulièrement anachroniques. De fait, Benteley et Cartwright jouent le rôle de héros problématiques en quête de valeurs qui ont peut-être autrefois existé mais qui n'ont plus de place dans la structure sociale de cet univers. C'est le souvenir très vague, détérioré, de ces valeurs libérales et humanistes qui les amène à agir.
Mais ils ne savent jamais très bien dans quel sens. Ce ne sont pas des héros problématiques qui exprimeraient la pensée de l'auteur quant aux valeurs et qui permettraient l'identification du lecteur. Leurs valeurs sont assez pauvres, dégradées, voire stéréotypées. Dick ne le laisse pas ignorer. Il n'a pas à proprement parler de porte-parole. Il se contente de conduire une action, une expérience sociologique. Il serait illogique que subsistent dans ce cadre des héros dotés d'un fort système de valeurs. Un autre aspect de cette expérience est la réponse du prolétariat manuel à l'aliénation : il adhère volontiers au Prestonisme, mouvement à la fois politique et religieux, teinté d'illuminisme, qui préconise l'émigration vers une planète peut-être mythique, une terre promise. Ici encore, il s'agit bien entendu d'une projection. Mais parce qu'elle est collective et peut-être parce qu'elle est issue d'une aliénation plus profonde encore que celle des classes moyennes, elle engendre de nouvelles valeurs transindividuelles, l'espoir et aussi l'appétit de découvrir, de « ne jamais s'arrêter »
, selon les propres mots de Preston.
La réponse (dans l'action) de Benteley, de Cartwright et de leurs semblables à l'aliénation et à l'oppression est toute différente. Elle prend la forme de la subversion, de la violence et de la fraude. Elle résulte des contradictions de la structure. Benteley trahit son patron, Verrick, parce que celui-ci l'a lui-même trahi. Cartwright fausse la Bouteille et accède de la sorte au Directoire pour faire aboutir le rêve prestonite. Ils récupèrent ainsi leur autonomie, la possession d'eux-mêmes. Benteley comprend que son aliénation a pris fin lorsqu'il découvre que, par un concours de circonstances, il s'est prêté serment à lui-même. Il n'est plus responsable que devant lui-même. Toutefois, la conclusion de ce remarquable roman n'appartient pas à Benteley ni à Cardwright mais aux Prestonites qui signifient, selon Dick, la pulsion la plus profonde de l'espèce, celle d'aller de l'avant, de faire sauter les structures ou de leur échapper, et il est logique, tout idéalisme mis à part, qu'elle soit accomplie par ceux qui n'ont rien à perdre. Il est tout de même frappant que Dick n'attende pas, à la façon de Marx, de la conscience collective d'une classe une réintroduction des valeurs, mais qu'il la fasse surgir du fond de l'aliénation elle-même.
En face de ces individus ou groupes plus ou moins conscients de leur aliénation et soucieux d'y échapper, se dresse la figure inquiétante du tueur, Keith Pellig. En réalité, Pellig est un robot, un homme synthétique. Il est aussi et surtout l'homme totalement aliéné, devenu pur objet, l'homme “truqué”. Ce “personnage” du robot, du simulacre, reviendra souvent dans l'œuvre de Dick.
Dans ce premier roman, Dick met en place toute la problématique de son œuvre à venir : celle de l'opposition entre des individus plus ou moins aliénés, et des monopoles contrôlés par des puissants qui sont les seuls héros réels de l'Histoire. L'échappée vers l'espace ou encore l'intrusion des extraterrestres, qui ne sont jamais des thèmes traités pour eux-mêmes, apparaissent cependant régulièrement en fond de décor, comme le signe de valeurs qui pourraient donner un sens à l'individu mais lui demeurent presque inaccessibles. Il s'agit là d'un phénomène de médiatisation. Une valeur est dite médiatisée quand elle est remplacée par autre chose — qui n'est pas un symbole — parce qu'elle ne connaît plus d'expression claire et qu'elle est inaccessible. Il y a une certaine analogie entre la médiatisation en sociologie et le fétichisme en psychologie.
À la lumière de cette analyse, la complexité touffue des œuvres suivantes s'éclaire. Dans les Chaînes de l'avenir (1956), Jones, héros du roman, tire sa puissance de sa capacité de prévoir l'avenir un an à l'avance. Nul ne peut lui échapper. Mais son aliénation découle de sa puissance même : le jour où il prévoit sa mort, il cède à la folie. Il tirait en effet sa valeur (à ses propres yeux) de sa puissance temporelle aux deux sens du terme. Sa mort annule cette valeur. Il se trouve donc rétrogradé au niveau des individus aliénés qui le servent et ne résiste pas à cette découverte. Dans les Marteaux de Vulcain (1956), la puissance aliénante est détenue par une Machine, c'est-à-dire une structure mise en place par une technocratie. La structure manifeste bientôt son autonomie sous la forme de tendances paranoïdes : elle n'agit plus que pour se défendre. L'idée frappante exprimée par Dick est qu'une société humaine, si elle se divise comme ici entre une classe d'experts et un prolétariat, donne les signes d'un trouble analogue à la schizophrénie ou à la paranoïa chez l'individu. Ainsi se trouve précisé le thème de l'homologie entre le fonctionnement psychologique d'un être humain et le fonctionnement sociologique d'une collectivité : cette homologie n'est pas seulement symbolique, elle a des conséquences : l'aliénation de la société peut déteindre sur l'individu et inversement ; elles se répondent. Il est intéressant de noter que, dans ce roman, la Machine en question est destinée à satisfaire un vieux rêve, la paix universelle : elle joue donc le rôle d'un “moi” envahissant, infecté par le “surmoi” et porté à censurer toutes les pulsions émotionnelles ou instinctuelles.
Avec les Mondes divergents (1957), Dick expose peut-être plus clairement cet affrontement dialectique entre l'aberration sociale et l'aberration individuelle. Jack Hamilton est physicien. Parce que sa femme, Marsha, a manifesté en quelques circonstances des opinions de gauche, il est menacé de perdre sa place. Un accident survenu dans le fonctionnement d'un accélérateur de particules projette les quelques personnes proches dans une série d'univers subjectifs ; tous plus déments les uns que les autres, ils révèlent ce que Hamilton pressentait : le vétéran respectable, la bonne mère de famille, l'institutrice sévère, le policier incorruptible sont tous cliniquement fous. Les valeurs “américaines” qu'ils prétendent illustrer et défendre prennent leurs racines dans leurs névroses. Hamilton tirera de cette exploration la conclusion qui s'impose. Incapable de conserver son poste dans un monde hystérique, et refusant la pitié, il choisira de monter sa propre affaire, de se comporter en personne responsable. Sa science au moins lui donne une certaine indépendance.
Docteur Futur (1960) expose aussi la tentative d'un individu libéral pour assurer son indépendance. Jim Parsons, médecin de son état, est projeté dans une autre époque. Mais il conserve une valeur indéniable, celle de son métier, l'art de guérir, qui lui appartient en propre et qui conserve sa signification dans toutes les sociétés. Cette valeur est symbolisée par sa petite mallette qui contient ses instruments. Mais cette confiance en l'individu libéral va s'estomper, sinon s'effacer tout à fait. Dans En attendant l'année dernière, le “héros”, médecin lui aussi, ne sera plus qu'un salarié, qu'un technicien. Le contenu des romans va devenir de plus en plus apocalyptique. Un certain nombre de signes, d'ailleurs déjà présents dans des ouvrages antérieurs, vont témoigner de la dégradation croissante de la situation des individus. Ainsi les relations entre les sexes, qui sont marquées par une agressivité névrotique. Il serait vain d'y chercher la preuve d'une misogynie de Dick. Plus simplement, il n'y a plus de place, en général, pour de “vrais” sentiments dans les couples, au moins dans la situation de départ des romans puisque les individus n'ont plus de valeur autre que marchande ou sexuelle. Le couple reproduit à son échelle l'aliénation dont souffre et se repaît toute la société.
Dans ce processus, le Maître du Haut Château (1962) marque une étape importante. Dick commence à décrire un monde où les Nazis et les Japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n'existent plus : ils ont été divisés entre à l'ouest un État occupé par les Japonais, à l'est un État dirigé par les Nazis, qui n'ont rien perdu de leur barbarie, et au centre un faible État américain. Dans cet univers, les structures sociales, les cultures se heurtent sans espoir. L'individu n'a aucune importance en dehors de sa propre vie. Il cherche tout au plus à survivre et à satisfaire ses besoins immédiats. La seule lueur d'espoir vient du fait que ce monde n'est peut-être pas réel. Un écrivain (l'“homme dans le haut château” du titre original) a publié en effet un livre qui décrit un autre possible : le nôtre. Ainsi subsiste la possibilité des valeurs. La question est de savoir quelles ont été les sources du livre. L'écrivain a-t-il eu accès à un monde parallèle ? Il révèle qu'il a écrit le livre en usant d'un jeu divinatoire chinois introduit par les Japonais, le Yi King. On voit réapparaître ici l'un des thèmes de Loterie solaire : pour des individus dépossédés d'eux-mêmes, la seule transcendance est celle du hasard. Les lois de l'univers ramènent à une combinatoire. La projection de l'aliénation est totale. Mais, en même temps, les valeurs apparaissent comme relatives aux circonstances historiques. La chance peut les réintroduire.

L'individu aliéné ne cesse pas pour autant d'exister, même si sa conscience est amoindrie. Il va donc, dans le cadre de son aliénation, essayer de contrôler son environnement et de s'y adapter. Dans Nous les Martiens (1963),(6) la réponse à un environnement physique hostile et à une tyrannie sociale (ici, l'oppression est le fait du chef du tout-puissant syndicat des plombiers) est un syndrome de retrait, une psychose à caractère schizophrénique. Parce que l'individu n'est plus relié, défini dans le temps et l'espace, le temps et l'espace cessent d'avoir pour lui une cohérence. Par un retournement caractéristique, Dick objective cette incohérence subjective : les schizoïdes parviennent effectivement à se déplacer dans le temps, à remodeler les événements, sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit d'une aventure intérieure (comme dans les Mondes divergents) ou d'un pouvoir réel. On remarquera que la même question peut se poser exactement dans les mêmes termes à propos de l'Année dernière à Marienbad, le film d'Alain Robbe-Grillet et d'Alain Resnais : les deux protagonistes se sont-ils déjà rencontrés ? La question de la réalité du pouvoir (ou de la rencontre) ne se pose vraiment que si l'on admet qu'il subsiste encore un espoir de quitter un monde aliéné ou de le changer. Comme celle de Robbe-Grillet, la réponse de Dick me paraît très ambiguë, sinon très franchement désespérée car il ne propose de solution, dès Nous les Martiens, que dans l'exaspération de l'aliénation.
Cette exaspération prend un tour curieux dans les Clans de la lune Alphane (1964). Une colonie composée d'un hôpital psychiatrique s'est trouvée isolée de la Terre pendant près d'un siècle. Les malades, puis leurs descendants, ont constitué une société composée de clans dont chacun correspond à une altération de la personnalité : il y a le clan des Maniaques, celui des Dépressifs, celui des Schizos, etc. Dans cette société qui fonctionne, l'aliénation institutionnelle fonde un système de normes. Dick complète ici sa proposition initiale : non seulement certaines structures sociales se trouvent à la source de l'aliénation, mais encore elles définissent comme aliénation tout ce qui leur est contraire, sous le couvert d'une nosologie scientifique. En d'autres termes, la société se sert, à l'occasion, du concept de l'aliénation pour aliéner, pour refuser un brevet de normalité à qui lui est étranger. Le fait que la doctoresse chargée de “rétablir l'ordre” dans la colonie souffre à son insu d'une grave névrose équivaut à une dénonciation.
Les ouvrages les plus récents de Dick, qu'il est malheureusement impossible d'analyser tous ici, reprennent et approfondissent ce thème de la solution de l'aliénation par l'exaspération de l'aliénation, ou aussi bien celui, inverse, de la suppression de la conscience de l'aliénation.
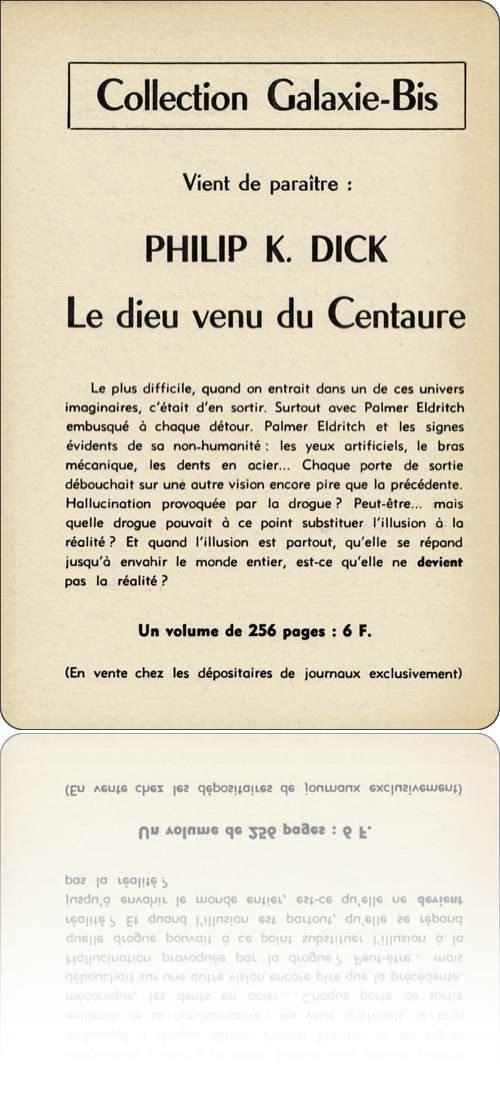
L'aliénation poussée à l'extrême permet en effet, selon Dick, la réintroduction de valeurs transcendantes ou plus simplement transindividuelles. Pour la bonne raison que l'aliénation résulte de la mutilation de l'individu par la société qui le prive de toute valeur, la rupture totale d'avec la société assure le salut de l'individu. Cette rupture peut être l'aboutissement de la folie ; elle peut également être provoquée par des drogues. Dans un cas comme dans l'autre, l'individu cesse d'être un objet et recouvre son autonomie, dans son enfer ou dans son paradis personnel. Mais comme l'Homme est un animal social, ces enfers et ces paradis communiquent, en dehors des voies de la société ambiante, et les frontières entre les personnalités ont tendance à se dissoudre. Ainsi dans l'admirable conclusion du Dieu venu du Centaure (1965), mais aussi, fréquemment, à un détour de phrases dans En attendant l'année dernière (1966) ou dans À rebrousse-temps (1967) : tout se passe comme si tel personnage devinait de temps à autre la remarque inattendue de son interlocuteur, comme s'il disposait de pouvoirs parapsychologiques.
On saisit alors la continuité entre la folie “naturelle” et celle induite par l'usage de la drogue : J-J 180 dans En attendant l'année dernière, qui permet de se déplacer dans le temps, et K-priss dans le Dieu venu du Centaure, qui permet d'envahir les personnalités. L'une et l'autre permettent de mourir à la société monopolistique et de devenir par rapport à elle un fantôme capable de franchir les murs et le temps et de hanter les consciences.
On voit également, ce qui sera parfaitement clair aux lecteurs d'En attendant l'année dernière et d'À rebrousse-temps, que le temps n'est pas dans l'œuvre de Dick une dimension physique, mais une dimension à la fois sociale et psychologique, plus précisément encore le type d'ordre par lequel l'individu s'insère dans la société, est contraint par elle, et duquel il parvient éventuellement à s'affranchir. Dick explicite franchement cette idée dans À rebrousse-temps en traitant un thème souvent esquissé mais jamais vraiment employé par ses prédécesseurs, celui du retournement du sens du temps physique : ce retournement ne change rien aux relations établies entre les êtres et les groupes sociaux. Les seules valeurs qui ont peut-être un sens, et qui sont ici portées par l'Anarque Peak, transcendent le temps physique. Incidemment, et sur un plan beaucoup plus trivial, je ne résiste pas l'envie de livrer aux lecteurs de Fiction l'étymologie du mot "sogum" qui sert à désigner cette substance (en réalité, les excréments) qu'absorbent pour se nourrir les personnages d'À rebrousse-temps : il s'agit, selon moi, des premières syllabes de Sodome et Gomorrhe.
Ainsi, toutes les œuvres de Dick (même celles qui n'ont pas été citées ici) se ramènent à une structure qui s'établit entre trois éléments principaux : des monopoles ou plus généralement une société organisée et oppressive qui est contrôlée par des personnages peu nombreux de l'Histoire ; des individus aliénés ou plus ou moins conscients de leur aliénation, dépourvus de toute valeur autre que marchande, et qui luttent désespérément pour obtenir leur autonomie, au besoin dans l'isolement, à l'image de ces petites machines autonomes et absurdes qui pullulent dans l'œuvre de Dick ; enfin une transcendance qui recouvre des valeurs médiatisées et qui prend volontiers la forme, quelquefois menaçante, d'extraterrestres. Le temps et l'espace sont seulement des modes de relation entre ces éléments. La folie, les drogues, les pouvoirs sont des résultats du fonctionnement d'une telle structure, qui, dans une perspective dialectique, concourent à sa disparition.
Deux choses au moins apparaissent dès lors certaines. La première est que la société visée par Dick est, comme il le dit lui-même, la société américaine, ou plus généralement toute société de monopoles. La seconde est que Dick ne porte pas, sauf peut-être dans ses premières œuvres, une condamnation morale au nom des valeurs libérales contre cette société, mais qu'il attend de ses contradictions qu'elle se dissolve elle-même pour laisser place à une forme plus avancée. L'aliénation apparaît, sous la plume de Dick, comme le ferment de la mutation, sinon comme la mutation elle-même. Au contraire de la plupart des écrivains de Science-Fiction, il ne voit pas dans la mutation et dans l'évolution au niveau de l'Homme l'effet d'une finalité ou d'une causalité biologique, mais le produit dialectique du développement de la structure sociale. Ce qu'affirme Dick, c'est que l'évolution de l'Homme s'effectue à peu près exclusivement dans et par le monde social.
Il est difficile de préciser, à moins d'une analyse délicate, ce vers quoi tend cette évolution selon Dick, c'est-à-dire la signification de la transcendance. Dick se montre remarquablement discret sur ce point et cette discrétion ajoute du reste au charme de son œuvre : il est un des rares auteurs à promettre plus qu'il ne tient, en matière de révélations, tout en se montrant capable de soutenir jusqu'au bout (et au-delà) l'intérêt. En ce sens, il est un véritable prophète : il amène à croire à ce qu'il annonce, même s'il ne le décrit pas. Cette transcendance annoncée semble bien recouvrir d'une part la réintroduction d'une valeur intrinsèque, non marchande, de la vie des hommes, qui rétablit à son tour la possibilité des valeurs transindividuelles, collectives. La schizophrénie n'est jamais, chez Dick, qu'une étape vers la reprise du dialogue rendue impossible par l'aliénation, même si cette reprise est rejetée dans un avenir inconnaissable. Cette transcendance semble bien, d'autre part, avoir une connotation religieuse, de type jungien. Mais nous croyons, sous réserve d'un examen approfondi, que Dick renverse la proposition jungienne : au lieu que ses héros trouvent accès à un espace métaphysique archétypal qui leur préexisterait, ils constituent, par leur propre expérience issue du fonctionnement de la structure sociale, un tel espace métaphysique. Peut-être Dick fait-il preuve d'une plus grande pénétration que Jung, en proposant, non pas que les dieux sont cachés au fond des Hommes, mais qu'ils sont la projection des problèmes des Hommes.
La question reste entière de savoir si Dick se perdra dans les méandres de ces projections, comme l'a fait peut-être Theodore Sturgeon, ou s'il trouvera dans son art le moyen d'une expression suffisamment complète de son problème pour qu'elle lui évite d'être aliéné à son tour. Il ne fait pas de doute que la littérature a une fonction équilibrante dans la vie de Dick. Mais son œuvre ressemble un peu à une course contre la montre ; chacun de ses livres cherche à réduire un aspect de l'aliénation évoqué dans le précédent. Comme beaucoup d'œuvres marquantes, celle de Dick a un double visage, celui de la fuite et celui de la poursuite.
Il est peut-être inutile de revenir au terme de cette étude sur le fait que Dick apparaît comme un homme de gauche. Ce fait a pourtant son importance pour une sociologie de la littérature de Science-Fiction. On peut en effet proposer dès à présent une typologie politique des auteurs de Science-Fiction. À droite se situeraient les écrivains qui croient encore aux valeurs libérales, à la possibilité pour l'individu d'en sortir par ses seuls moyens, ainsi Robert A. Heinlein, Edmond Hamilton, Poul Anderson et, dans une large mesure A.E. Van Vogt. À gauche se trouveraient des auteurs qui s'inquiètent du sort de l'individu face à une société de monopoles, soit dans le contenu, soit dans la structure de leurs œuvres, comme Fritz Leiber, Philip José Farmer et bien entendu Dick. On pourrait en fin rapporter à une tendance anarchisante, toujours difficile à situer à l'extrême-droite ou à l'extrême-gauche en termes de sociologie politique, des auteurs comme Clifford D. Simak, Ray Bradbury, et peut-être Harlan Ellison, qui dénoncent bien l'écrasement de l'individu par la société américaine contemporaine, mais au seul nom des valeurs médiévales ou libérales, du bon vieux temps, et qui sont, de ce fait, condamnés au pessimisme. Une telle classification pourrait être étendue à tous les auteurs au seul examen de leurs œuvres sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient un contenu politique explicite. Il est intéressant de voir qu'elle recoupe les attitudes manifestées par ces auteurs à l'endroit de la guerre du Việt Nam.(7) Quoi qu'en pensent certains lecteurs, il n'est pas si facile d'échapper à toute expression d'une pensée politique.
La question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi les écrivains de Science-Fiction dans leur ensemble et Dick en particulier expriment aussi nettement dans la structure ou le contenu de leurs œuvres des problèmes sociologiques et finalement politiques. Je propose ici une hypothèse selon laquelle la Science-Fiction, parce qu'elle néglige dans une certaine mesure la description des relations inter-individuelles qui fonde encore le roman traditionnel, et parce qu'elle privilégie la relation plus universelle entre l'Homme et l'univers, serait l'occasion d'une projection plus transparente de la situation du groupe social de l'auteur dans la société globale. Que cette projection s'effectue souvent à l'insu de son auteur ne change rien à l'affaire. C'est un des mérites de la brillante intelligence de Dick que d'en avoir exploré et partiellement élucidé le mécanisme.
- Les titres français pour les textes traduits depuis la première publication du présent article ont été restitués par Quarante-Deux.↑
- Redevenu l'Œil dans le ciel en 1976. — Note de Quarante-Deux.↑
- Devenu Dedalusman en 1974 puis le Zappeur de monde en 1988. — Note de Quarante-Deux.↑
- Voir l'article paru dans New worlds en septembre 1966 qui sert d'introduction à En attendant l'année dernière suivi d'À rebrousse-temps au Club du Livre d'Anticipation, 1968.↑
- On a appris depuis que la dernière phrase du texte (
« … À des centaines de kilomètres de là, une autre bête semblable à la première sortait de son souterrain et allait se terrer aux creux d'un dépotoir. »
) a été ajoutée par le traducteur, Alain Dorémieux. — Note de Quarante-Deux.↑ - Devenu Glissement de temps sur Mars en 1981. — Note de Quarante-Deux.↑
- Cf. Fiction, nº 175, juin 1968, p. 157.↑