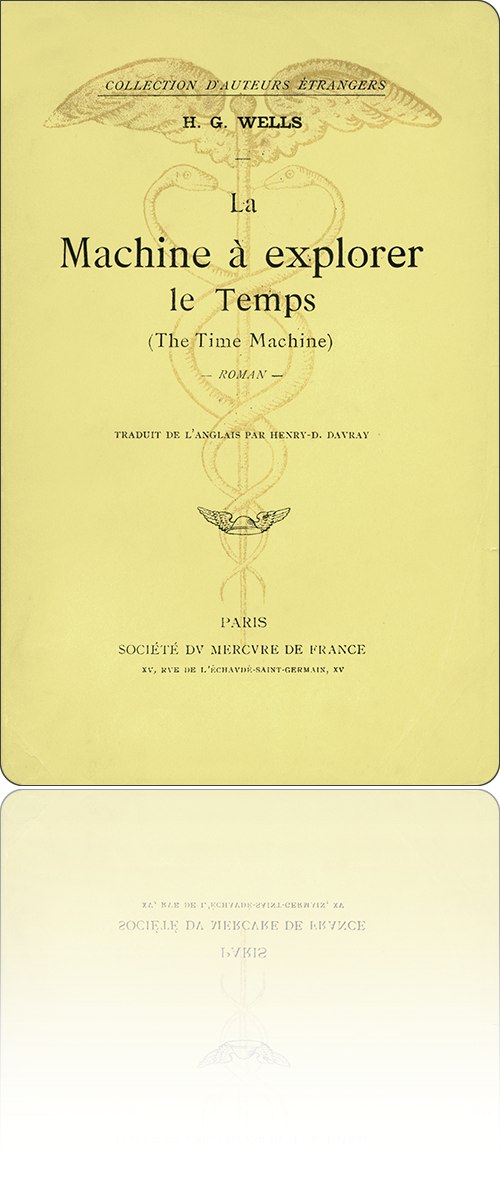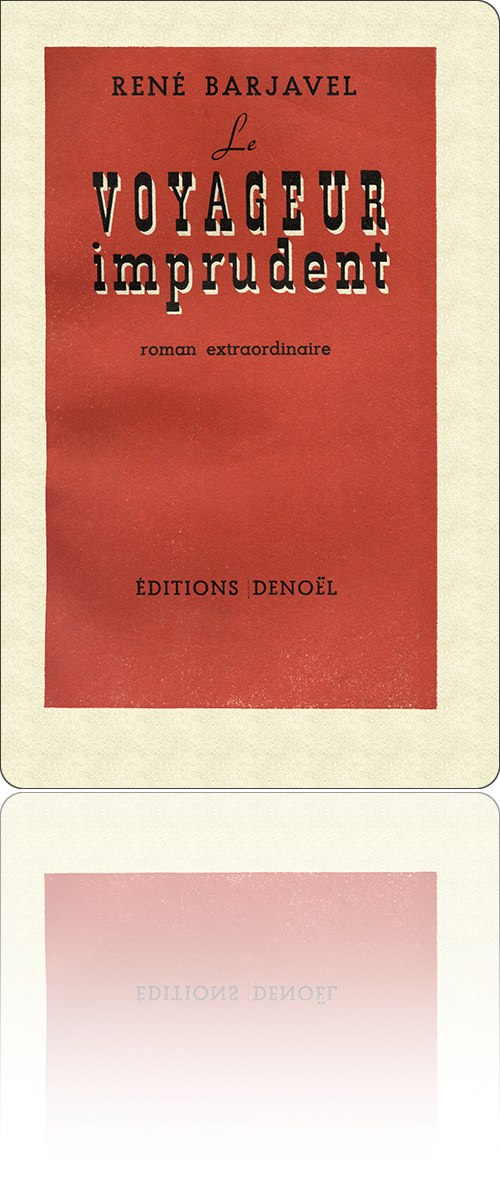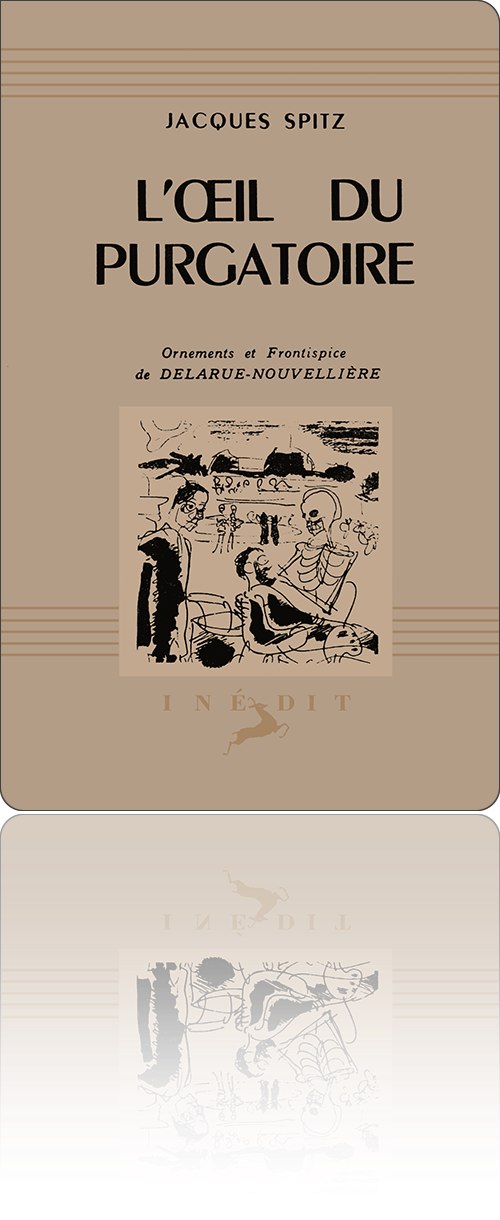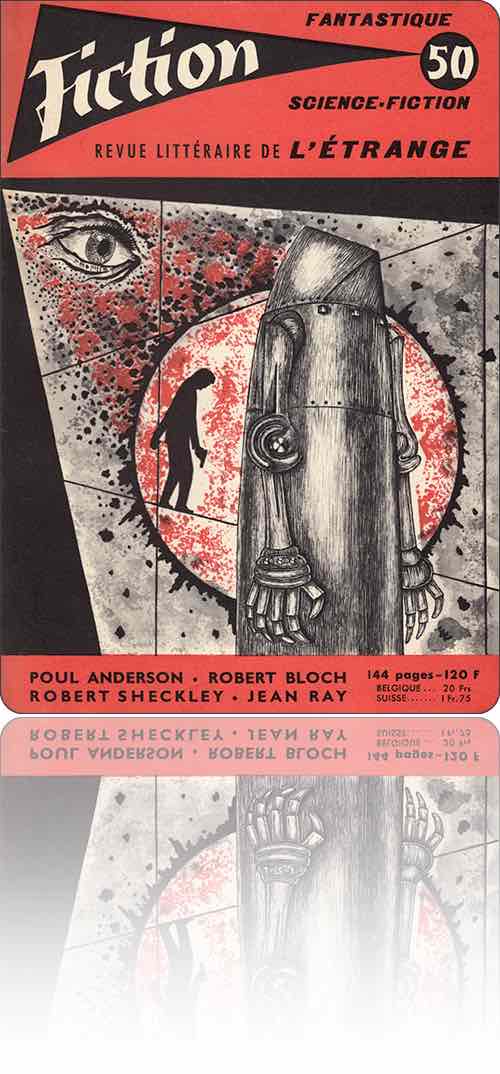les Problèmes du temps
avec Gérard Klein, dans le cadre de la rubrique Ici, on réintègre de Fiction, 1958
- par ailleurs :
- amazon.fr [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
- exliibris.biblio
Le premier article de cette série, qui date de juin 1956, avait défini les bases du voyage interplanétaire à travers trois livres choisis en toute connaissance de cause et ceci en plongeant dans les profondeurs d'un passé somme toute assez proche.
La longue période de temps qui s'est écoulée entre cet article et la parution du second pourrait s'expliquer par un long travail d'érudition ; en fait, elle est due à la fermeture momentanée d'une source d'information capitale.
Notre étude traitera cette fois des problèmes du temps. En nous laissant entraîner par la Machine à explorer le temps de H.G. Wells (The Time Machine, 1895, paru en France en 1906), guider par le Voyageur imprudent de René Barjavel (1944), piéger par l'Œil du Purgatoire de Jacques Spitz (1945).
Pendant fort longtemps, les seules machines à explorer le temps furent les livres, les marbres ou les cires qui ont dévalé les pentes du temps pour nous restituer un fragment de passé intact.
Hérodote, Platon, historiens, utopistes, ont tenu longtemps l'écoulement du temps pour quelque chose d'irrémédiable et seule l'idée d'un voyage purement intellectuel dans le temps leur était perceptible. Pour eux, le temps se différenciait des autres facteurs physiques : il n'était pas une grandeur comme les autres, il était difficilement mesurable, il possédait certaines qualités métaphysiques, il était divin.
Des calendes grecques au millième de seconde, le temps s'est précisé, circoncis, réduit ; chaque mesure du temps a pris sa valeur propre en dehors de toute incertitude, de tout mystère ; il a été broyé par les rouages des horloges, le xixe siècle l'a enfin canalisé.
Le temps se trouve alors limité par une prodigieuse opération mentale à une dimension comme les autres, et la question se pose immédiatement à l'esprit de savoir si l'on ne pourrait pas voyager physiquement dans le temps comme l'on voyage au long des trois autres dimensions perceptibles à l'Homme.
De la prophétie, de l'utopie futuriste à la notion de voyage temporel, un pas énorme a été franchi, celui qui sépare l'Enfer des usines monstrueuses, les îles enchantées de Luna Park, les navires à voiles du Chris-Craft. Et, comme l'a minutieusement décrit Ernst Jünger dans son Traité du sablier, le cadran solaire, le sablier, des horloges à rouages.
Là, comme dans bien d'autres domaines, Wells a ouvert une voie dans laquelle se précipitèrent bien d'autres avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins d'originalité. Aucun de ces livres n'épuise le sujet des voyages dans le temps, mais ils le jalonnent assez bien et semblent converger vers une réalité future de la machine à voyager dans le temps.
H.G. Wells cristallisa pour la première fois la notion du temps en physique en trois remarquables essais qui parurent en 1894. Il avait fallu trois siècles et quelques tonnes d'horloges de précision pour en arriver là.
La Machine à explorer le temps, du même auteur, qui date d'un an plus tard, sut se libérer des frontières technologiques qu'imposait son siècle pour plonger résolument dans le domaine de l'imagination.
Cette phrase quelque peu sibylline est peut-être la clef du roman, le germe d'une des plus fabuleuses aventures intellectuelles qui furent offertes à l'Homme : « Il n'y a aucune différence entre le temps et l'une quelconque des trois dimensions de l'espace sinon que notre connaissance se meut au long d'elle. »
.
Le roman de Wells est trop célèbre pour qu'il soit nécessaire de le raconter en détail. Disons seulement que le voyageur du temps, par un souci théâtral qui situe bien l'époque à laquelle fut conçu le roman, réunit ses amis secrètement pour leur livrer le fruit de ses travaux, une machine conçue et dessinée par le spectre d'Albert Robida, d'ivoire, de cuivre, aux dessins excentriques. Et, sous les yeux incrédules de ses contemporains, l'explorateur du temps disparaît de l'univers présent.
Après cette introduction teintée d'humour anglais, nous plongeons directement dans le futur. An huit cent deux mille sept cent un. L'Humanité s'est biologiquement transformée. Elle s'est divisée en deux groupes : d'une part, des êtres fragiles, les Éloïs, élégants mais instables, vestiges décadents d'une civilisation parvenue à un haut degré de raffinement, vivants comme de perpétuels enfants à la surface de la Terre, jouant dans les jardins profonds ; d'autre part, terré dans les entrailles de la planète, un peuple de lémuriens, les Morlocks. Et la dépendance des premiers à l'égard des seconds est totale puisque les Éloïs ne produisent rien, se laissent griser par les plaisirs d'un monde qu'ils ne possèdent plus, tandis que les Morlocks, privés depuis des siècles de la jouissance de la Terre, sont devenus naturellement industrieux, travaillant, produisant, suivant la ligue sociale qui les avait précipités là.
Les Éloïs sont presque asexués et il naît entre le voyageur du temps et Weena, geisha des temps futurs, un amour impossible fait de tendresses, d'incertitudes. L'explorateur du temps ne peut se stabiliser, ce prodigieux bond dans le temps l'a déséquilibré ; tantôt il se laisse saisir par la situation présente, tantôt les coutumes de son temps reprennent le dessus sans qu'il puisse retenir ce flot qu'il a déchaîné. Les Morlocks lui ont enlevé la machine et cette halte de dilettante se transforme lentement en cauchemar, cauchemar qu'il fuira lorsqu'il aura retrouvé son bien.
Désormais, il brûlera les années. Après avoir goûté aux millénaires, il franchira des millions d'années, jusqu'au temps où la vie s'achève…
Le déclin de l'Humanité : le ciel est crépusculaire, les rivages de sable battus par la mer, fade et grise, portent les énormes crabes de la fin du temps qui, un million d'années plus tard encore, ont disparu, laissant place à des êtres inertes, sortes d'hydres couleur de néant, rampant sur la planète immobile, au temps zéro de l'Histoire. La vie se réfugie enfin en ce lieu d'où elle est venue, la mer. La tristesse des dernières pages de la Machine à explorer le temps est extrême, et nous ne connaissons guère que la nouvelle de John W. Campbell, Jr., "le Ciel est mort" (1935), pour restituer ainsi l'émotion qui s'exhale des mondes morts, des ruines sur lesquelles le temps n'aura plus prise.
Ainsi Wells aboutit à un non-lieu ; le temps n'a de fin qu'en lui-même, l'Homme ne saurait le dépasser, et pourtant le héros, de retour à son point de départ, n'aura de cesse qu'il disparaisse dans les profondeurs du passé, mort, enfui, mangé.
Il s'agit surtout, on le voit, d'un voyage linéaire dans le temps, d'une sorte d'excursion. Les problèmes exposés sont des problèmes historiques ; qu'ils relèvent de l'art de l'utopiste ou des extrapolations de l'astronome, ce ne sont que des questions d'ordre chronologique. L'une des idées maîtresses exprimées dans le livre de Wells est celle de l'évolution de plus en plus différenciée des aristocrates et de la classe ouvrière, les premiers devenant les victimes des seconds par un logique retour des choses.
Il n'y est pas question de paradoxe temporel, abstraction faite de celui qui consiste à imaginer une machine à voyager dans le temps. Le temps est seulement considéré dans la durée comme un élément nécessaire de l'histoire, de l'évolution et du déclin des espèces et des mondes.
Le principe de la plus grande partie du livre de René Barjavel, le Voyageur imprudent, n'est pas très différent de celui du livre de Wells, quoiqu'il y ait chez l'écrivain français un très grand souci d'originalité dans le détail, qu'expliquent sans doute cinquante années d'écart. Les procédés de voyage ne sont pas les mêmes : Barjavel a imaginé la Noëlite, substance qui dérobe ce qu'elle recouvre à l'action du Temps, un peu comme la Cavorite de Wells (dans les Premiers Hommes dans la Lune) dérobait les corps à l'action de la gravitation, mais le principe du voyage reste semblable. La Noëlite suspend dans le présent et une légère impulsion suffit à faire dériver cette bulle de temps au travers des années.
Comme ses livres précédents pouvaient le laisser prévoir, Barjavel est antimoderniste. S'il imagine l'Humanité dans un nombre respectable de siècles, il la conçoit réduite à l'état de fourmilière dotée d'espèces spécialisées : les soldats, robots de chair, les estomacs vivants, les guetteurs aux yeux pédonculés, les siffleurs d'alarme, et les amas obscènes de cerveaux qui baignent dans le sérum physiologique au cœur des cuves translucides. L'âme de la ruche l'a emporté sur la conscience individuelle. L'amour lui-même en est réduit à la dissolution du mâle, l'homme-spermatozoïde, qui se fond tout entier dans le sein hypertrophié de la Mère.
Mais Barjavel ne se contente pas de l'utopie, bien que le voyage dans le temps soit devenu depuis Wells un support commode à ce genre littéraire ; il commence à jongler avec l'idée du temps-dimension.
Ses personnages peuvent se projeter dans toutes les directions du temps comme il nous est loisible de le faire dans l'espace ; dès lors, le paradoxe apparaît, jalonné par autant de détails savoureux, par des notations cruelles.
Saint-Menoux, le héros, remonte dans un passé proche et se rencontre lui-même, et les deux hommes vêtus de leurs scaphandres verts passent une joyeuse nuit. Ou encore, il invente un réfrigérateur extra-temporel dans lequel les aliments demeurent éternellement dans le présent. Puis c'est l'image hallucinante de la pluie de temps, la vision d'une petite ville lointaine arrosée par une pulvérisation de présent, des habitants qui restent, cloués par leurs membres dans un temps immuable, alors que leurs corps périssables vont pourrir autour de cette crucifixion temporelle.
Saint-Menoux en viendra à mettre en échec la mort elle-même. À la lecture, il devient évident que tous ces paradoxes ont une commune essence, l'éternelle question : une autre histoire aurait-elle pu se dérouler à la place de la nôtre ? Qui se complique de l'inquiétude de celui qui se demande : « Puis-je modifier l'avenir, le présent et le passé, puis-je dominer le temps puisque j'en possède toutes les données ? »
.
Saint-Menoux décide de tenter quelques expériences. Revêtu de son scaphandre vert, il commet des vols spectaculaires dans le passé et, de retour dans son présent, il constate qu'ils ont laissé une trace, que des livres ont été écrits sur le “Diable vert” et que lui-même, passionné par ces problèmes, a écrit une théorie importante sur ces apparitions passées.
Mieux, il s'aperçoit qu'il introduit des modifications dans son propre passé et dans celui des gens qu'il connaît, tandis que sa mémoire devient très rapidement brumeuse à propos de l'ancienne réalité.
Le temps, conclut-il, demeure logique avec lui-même, il inclut dans une part de liberté une part de fatalité ; on ne peut le modifier sans être modifié soi-même. Ces perturbations de la mémoire posent de bien troublants problèmes : n'avons-nous pas l'impression de nous souvenir de faits ou d'images dont nous ne retrouvons pas la trace, ou encore d'accomplir pour la seconde fois une action, étant certains de ne l'avoir pas commise ?
Peut-être le passé et le futur s'interpénètrent-ils constamment, modifiant constamment l'espace temporel autour de nous ?
Dans son roman, Barjavel décide de pousser le paradoxe jusqu'à l'extrême : le héros décide de tuer Bonaparte avant qu'il se soit engagé dans l'Histoire. Mais la fatalité ne se laisse pas faire ; tout se passe comme si le temps, entité, protégeait son propre déroulement et, au moment où Saint-Menoux tire sur Bonaparte, un soldat le protège de son corps en s'interposant entre la balle et le futur empereur. Or, cet homme est l'ancêtre direct de Saint-Menoux, mais à cette époque il ne s'est pas encore marié et, mort, il ne pourra procréer.
L'imprudent voyageur, victime de sa dangereuse expérience, disparaîtra dans les brumes d'un non-temps, imprimant comme seul souvenir dans le cœur de la femme qu'il aimait un cri déchirant.
Le paradoxe, on le voit, résulte du nœud d'une certaine logique, d'une rétroaction de l'effet sur la cause qui, supprimant la cause, entraîne la disparition de l'effet. Mais Barjavel ne pousse pas ses conclusions jusqu'à l'absurde : si Saint-Menoux n'est pas né parce qu'il a tué son ancêtre, il n'a pas pu être là pour le tuer, donc il est né et dès lors il a pu le tuer. La seule échappatoire est d'admettre que plusieurs réalités peuvent coexister parallèlement et se dérouler selon d'autres directions que celles du temps. Dans la postface à une réédition de ce roman, il s'explique d'ailleurs sur les problèmes que fait naître son paradoxe.
Le paradoxe n'existe que par les mots, précisément parce qu'il est démontré avec des mots qui excluent la formation de chaînes causales dans d'autres directions que celles qui vont du passé vers l'avenir.
Ainsi l'auteur américain William Tenn put aboutir à "Comment fut découvert Morniel Mathaway" (1955), cette remarquable histoire où un peintre médiocre reçoit des reproductions de ses œuvres à venir. Ces tableaux sont splendides et dignes de l'artiste célèbre qu'il sera dans l'avenir. Il recopie donc ces toiles, devient effectivement célèbre et le cercle est bouclé. Mais qui, en réalité, a peint ces tableaux ? La question reste entière, un élément nouveau est entré dans la chaîne causale selon une autre direction que celle du temps.
Et c'est bien d'un voyage dans la causalité que parle Jacques Spitz dans son hallucinant roman l'Œil du Purgatoire, qui parut approximativement à la même époque que celui de René Barjavel.
Car le temps n'est plus la seule direction dans laquelle s'égare notre voyageur ; il semble qu'il suive en même temps une autre de ces directions dont nous parlions plus haut, qui sont difficilement définissables mais dont la nécessité paraît évidente. Un étrange savant, plutôt fou, légèrement démoniaque, sert d'aiguillage au héros. C'est presque par défi, par souci de tenter l'impossible, que celui-ci accepte de s'oindre les yeux d'une substance qui l'enverra ailleurs.
Alors commence un voyage immobile dans l'avenir, ou plutôt une projection du présent dans l'avenir. Il verra chaque chose, chaque objet familier, chaque personnage de sa vie au moment même où l'incidence temporelle, la fatalité historique les a placés à ses côtés, mais avec leur visage, leur aspect futur.
Et le délai s'agrandira au fur et à mesure que cette “maladie” s'aggravera. Au commencement, les quotidiens qu'il achètera seront déjà froissés dans sa main, chiffonnés, salis ; il les verra tels qu'ils seront prochainement. Son miroir renverra l'image d'un homme barbu au moment où il vient de se raser. Il frottera des allumettes calcinées sur un grattoir usé pour allumer une cigarette de cendres d'une flamme déjà éteinte.
La chose apparaît plus grave lorsque les aliments qu'il voudra absorber seront déjà digérés dans son assiette. Son dégoût s'intensifie, et pourtant rien n'a changé ; seul son regard le transporte dans l'avenir : il suffit que ses yeux se referment pour que chaque chose retrouve, au toucher, son aspect présent.
Mais sa vue s'altère de plus en plus. Après avoir vu des femmes nues, vêtues de quelques haillons, se promener dans la rue, traînant un cadavre de chien, il ne distingue plus que des squelettes, puis les squelettes dépareillés de ses contemporains. Jusqu'à ce qu'il ne puisse voir que les “Formes”, les idées que les gens se font d'eux-mêmes — leurs âmes éternelles ?
Ici, le paradoxe ne limite plus son support au temps-dimension. Par un étrange retour des choses, il rend une valeur métaphysique au temps, puisque celui-ci devient le Purgatoire qui mène à l'Enfer.
On voit que Jacques Spitz, au ton d'ordinaire plus caustique, se laisse aller, entraîné par son propre sujet, à des considérations métaphysiques. Et c'est là le secret du charme subversif de ce livre, cette progression, ce passage lent du domaine de l'humour à celui de la Science-Fiction et, au-delà, vers de vertigineux abîmes.