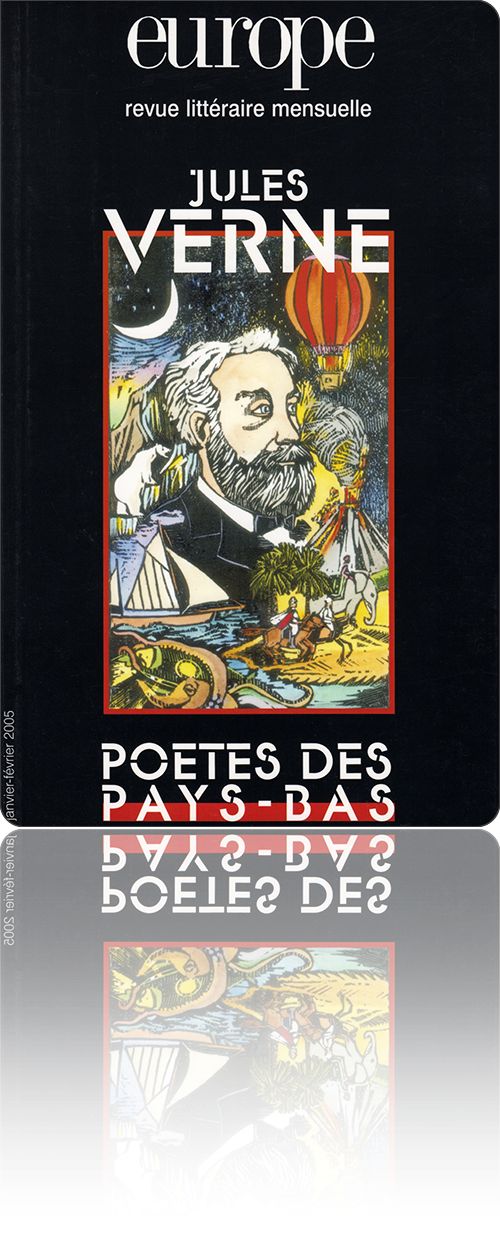Naviguons sur l'Île à hélice
dans le cadre du dossier Jules Verne de la revue Europe, 2005
- par ailleurs :
« Les temps sont venus. L'homme a pris possession
De l'air comme du flot la grèbe et l'alcyon.
Devant nos rêves fiers, devant nos utopies
Ayant des yeux croyants et des ailes impies… »

Jules Verne a composé les Voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus en exploitant les opportunités fournies par les quatre éléments. L'air conquis à l'aide de ballons, d'obus, de débris de planètes comme dans Hector Servadac, et même du plus lourd que l'air avec l'invention de Robur. La Terre a été parcourue par la maison à vapeur, sans compter les nombreuses explorations par les moyens normaux de locomotion : au pays des fourrures, en Chine, ou dans les steppes parcourues par Michel Strogoff. Jules Verne a utilisé le feu des volcans pour permettre, entre autres, la sortie du centre de la Terre. Les eaux lui ont beaucoup servi : celles douces du superbe Orénoque, celle des océans parcourus par de nombreux navires, sans compter les vingt mille lieues parcourues sous les mers. S'il a rarement envisagé des futurs, mis à part "la Journée d'un journaliste américain en 2889", il a cependant exploité des utopies comme Franceville, et des robinsonnades dans Deux ans de vacances. Cependant, il n'a jamais écrit de récits qui impliquent à la fois des voyages marins au moyen d'une invention technique, associés à une utopie fondée sur une technologie nouvelle mais financièrement élitiste, et qui se révèle néfaste — le tout dans un futur distant — avant l'Île à hélice (1895).(1) Ce roman n'a guère attiré l'attention des critiques.(2) Il est d'une écriture moins poétique et d'une visée plus didactique que l'Île mystérieuse ou Vingt mille lieues sous les mers. Mais il permet un voyage assez extraordinaire dans l'univers idéologique du monde vernien.
une Future utopie technologique
Notons d'emblée que cet ouvrage a, pour origine lointaine, le seul grand voyage maritime effectué par Jules Verne. Avec son frère, sur le Great Eastern, un paquebot anglais construit en 1858, ils iront en Amérique du 18 mars au 28 avril 1867, et jusqu'aux chutes du Niagara.(3) Un lien entre ce voyage en paquebot et notre roman figure dans une lettre écrite par Jules Verne alors qu'il arrive en vue de New York :
« Vous voyez, mon cher Hetzel, que nous ne savons rien, que nous sommes comme les sauvages sur notre île flottante, mais quelle île ! Quel échantillon de l'industrie humaine ! Jamais le génie industriel de l'Homme n'a été poussé plus loin. […] C'est une huitième merveille du monde que ce navire. ».(4)
Le décalage entre Great Eastern et Standard Island (qui est le nom de l'île à hélice) est temporel. Nous quittons l'an 1867 pour nous retrouver bien après 1974 (seule date précisée dans le texte, et présentée comme révolue). Au lieu du paquebot, géant pour l'époque, et qui articule à la fois les voiles et la vapeur, nous nous trouvons sur une île artificielle géante : « Un Great Eastern modernisé sur un gabarit des milliers de fois plus considérable. »
(p. 51). C'est aussi, selon le surintendant, « Un morceau de planète supérieure tombée en plein Pacifique, ou encore un Éden flottant où se sont réfugiés des sages. »
(p. 78).
L'île est de forme ovale ; elle est divisée en deux sections séparées par la Unième avenue, longue de trois kilomètres (p. 52). Elle est en acier, et formée de 275 000 caissons. Elle possède deux ports, l'un à bâbord, l'autre à tribord, avec chaque fois des moteurs pour les hélices, alimentés par des usines proches et fournissant l'électricité requise pour les hélices, car « l'électricité est l'âme de l'univers »
(p. 57). Elle est produite par des usines qui consomment le pétrole que des navires apportent dans chacun des deux ports. Les camions comme les chaloupes sont électriques, ainsi que les trottoirs roulants des grandes artères. Les habitants profitent d'un grand confort.
Dans les appartements : eau chaude ou froide à domicile « comme nous distribuons la lumière, le son, l'heure, la chaleur, le froid, la force motrice, les agents antiseptiques »
. On produit aussi « de la pluie sur commande »
(p. 48).
Chacun est sous surveillance médicale : « Chaque habitant connaît exactement sa constitution, sa force musculaire mesurée au dynamomètre, sa capacité pulmonaire mesurée au spiromètre, son degré de force vitale mesuré au magnétomètre. »
(p. 54). Il existe, pour les enfants, des écoles où « des professeurs payés comme des ministres »
(sic) dispensent « une instruction gratuite et obligatoire »
(p. 78). La vie est facilitée par la modernité des communications :
« La plupart des commandes se font téléphoniquement et même téléautographiquement. […] Le téléautographe est un appareil perfectionné qui transporte l'écriture comme le téléphone transporte la parole, sans oublier le kinétographe qui enregistre les mouvements et qui est pour l'œil ce que le phonographe est pour l'oreille, et le téléphote qui reproduit les images […] nous pouvons signer électriquement des mandats ou des traites. » (p. 31)
Il existe des bibliothèques — où se trouvent des « livres phonographiques »
ainsi que des journaux, dont certains, distrayants, sont imprimés « sur pâte comestible avec une encre de chocolat »
— et un musée, qui ne comprend évidemment pas de peintres impressionnistes, car on échappe ici à « cette invasion de la peste décadente »
(p. 75). De même, on utilise une « électroculture »
pour accélérer la production et la taille des légumes. Les distractions abondent : les « théâtrophones »
sont des salles de concert. « La compagnie possède des câbles sous-marins dont l'un est au port d'attache, l'autre soutenu par des bouées »
. Et lorsqu'on désire entendre un chanteur depuis l'île, « on repêche un câble, on envoie un ordre téléphonique aux agents du port d'attache qui établissent la communication. On raccorde les fils ou les câbles de tel théâtre ou salle de concert […] les spectateurs applaudissent et les applaudissements sont renvoyés aux acteurs par fil de retour »
(p. 68).
Il existe aussi « un fumoir où l'on envoie la fumée directement au domicile du fumeur, dégagée de la nicotine et aspirée par des bouts d'ambre spéciaux pour chaque amateur »
(p. 74).
Pour éviter les conflits, les habitants, au nombre de 10 000, sont tous étasuniens — hormis quelques spécialistes, comme Athanase Dorémus, un Français qui enseigne « la danse, la grâce et les bonnes manières »
. Ou encore le quatuor de musiciens français que l'on a kidnappé, puis que l'on achète afin qu'il demeure sur l'île, pour le seul plaisir des milliardaires, et qui va servir de “personnage caméra” pour décrire d'abord l'île, puis les aventures des voyages dans les mers du Sud. Les habitants de l'île sont catholiques romains, avec leur église « de style gothique »
(p. 39) ou protestants, « fidèles à la doctrine calviniste »
. C'est une ville indépendante, « cité libre sur laquelle l'Union n'a aucun droit, qui ne relève que d'elle-même »
(p. 33), une « incomparable cité sans rivale au monde […] fondée en s'appuyant sur une dose phénoménale d'énergie morale »
(p. 44), et d'ailleurs « il n'y a en cette cité que des nababs richissimes »
(p. 32), dont la capitale est Milliard City, « cité gouldienne, vanderbiltienne, rotschildienne »
(p. 48).
Ce n'est pas sans raison avouée que cette île est étatsunienne car, ainsi que le précise le narrateur omniscient, les USA ont phagocyté leur environnement proche :
« Dans le cours de ces années-là — nous ne saurions le préciser à trente ans près —, les États-Unis d'Amérique ont doublé le nombre d'étoiles du pavillon fédératif. Ils sont dans l'entier épanouissement de leur puissance industrielle et commerciale après s'être annexé le Dominion of Canada jusqu'aux dernières limites de la mer Polaire, les provinces mexicaines, guatémaltèques, hondurassiennes, nicaraguiennes et costariciennes jusqu'au canal de Panama. » (p. 8)
Après quoi comme les nababs de l'île, « ils se sont infusés le sens des belles choses qui leur avait manqué si longtemps »
(p. 8), ce qui explique évidemment la présence d'Athanase Dorémus et l'enlèvement du quatuor musicien. La visite de l'île et de ses avantages prend fin avec une première partie. La seconde entame le voyage de l'île dans le Pacifique.
un Voyage touristique et ethnographique
Cette île, bien que reliée par des câbles téléphoniques et télégraphiques à la terre ferme, n'est pas fixée au rivage : elle se déplace « conformément au programme arrêté par l'administration supérieure sur avis des météorologistes de l'observatoire »
(p. 55) afin que les nababs jouissent du meilleur climat toute l'année. Mais comme le remarque le narrateur, anticipant sur la catastrophe prévisible : « En créant ce domaine artificiel lancé à la surface d'un vaste océan, le génie humain n'a-t-il pas dépassé les limites assignées à l'Homme par le Créateur ? »
(p. 85). C'est une hypothèse qu'on discutera.
Jules Verne, outre ses romans, a publié des ouvrages encyclopédiques comme la Géographie illustrée de la France et de ses colonies (1868) en collaboration avec Théophile Lavalée, la Découverte de la terre (1878), les Grands navigateurs du xviiie siècle (1878) et les Grands navigateurs du xixe siècle (1880) — les deux en collaboration avec Gabriel Marcel.
Il connaît Élisée Reclus, qu'il cite nommément et qu'il utilise abondamment.(5) Il se sert de ce savoir afin de donner un tour pédagogique à cette croisière touristique de l'île à hélice dans les mers du Sud, depuis les îles Sandwich jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en passant par Tahiti, les Marquises et les Fidji. Ce qui nous vaut, soit par la bouche du narrateur soit par le biais du quatuor, des remarques et des observations à propos des îles et des autochtones rencontrés, ainsi que sur les divers états et changements apportés par la colonisation de ces îles. L'occasion est alors donnée au lecteur de réfléchir sur « tous les maux qu'entraîne la conquête, même si les conquérants appartiennent aux races civilisées »
(p. 122).
Nos quatre Français vont donc servir de truchement pour nous faire découvrir les plaisirs et les singularités de ces îles lors de ce périple, qui est entamé dès cette seconde partie de l'ouvrage. Les données sur la géographie, la généalogie des rois et des reines des terres visitées, les conflits dus à la colonisation par les Anglais, les Français ou les Étasuniens, les alliances nouées, les traîtrises, toutes ces informations datent de ce que l'on sait en 1894 et que Verne a découvert en écrivant ses ouvrages pédagogiques. Il est curieux de constater qu'à quelques pages de distance le texte propose des options différentes. Tantôt le processus de “civilisation” est présenté comme positif : « Les missionnaires ont rivalisé de dévouement et de zèle. Méthodistes, anglicans, catholiques rivalisant d'influence ont fait œuvre civilisatrice. »
(p. 96). Ou encore : « Le prêtre wesleyen dit avoir fort à faire pour arracher ses fidèles à l'amour du “bukalo” — de la chair humaine. »
(p. 252).(6) Tantôt le tableau est moins enviable et invite à s'interroger : les autochtones « ignoraient autrefois les bronchites, les pneumonies, la phtisie »
(p. 125).
La plupart du temps, notre quatuor se livre à des remarques comparatives de « touristes »
(p. 249) sur les us et coutumes des populations rencontrées. Ils sont sensibles aux vêtures féminines et insistent sur la beauté des Tahitiennes en référence au voyage de Bougainville (p. 155). On y retrouve même la reine Pomaré (ou une de ses descendantes). « Aux Fidji, les femmes sont vêtues d'un simple pagne noué autour des reins ; elles n'éprouvent aucun étonnement à la vue des étrangers. »
(p. 253). Les musiciens s'intéressent aux différentes danses : la bamboula « aux déhanchements caractéristiques »
est opposée aux musiques et danses civilisées que sont la polka ou le menuet et qu'enseigne Athanase Dorémus, professeur de danse, de grâce et de maintien. Ils s'interrogent aussi sur les peuples et leur degré d'humanité : « Les Papous sont des êtres relégués au bas de l'échelle humaine […] la race de ces Canaques, d'origine inférieure ne s'est pas revivifiée avec le sang polynésien. »
(p. 274). Quant aux « Polynésiens, Mélanésiens et autres, sont-ils différents des enfants ? »
(p. 242).
Hormis l'existence de cette gigantesque île à hélice,(7) et le fait qu'en 1974 on a amélioré l'entrée du port d'Honolulu, rien ne suggère que l'on soit dans un univers futur par rapport à la date de publication du roman. Rien non plus qui montre que les mentalités aient évolué, que les rapports entre les peuples autoproclamés “civilisés” et les peuples colonisés aient changé. Jules Verne reproduit ici le discours encyclopédique du xviiie siècle, classificateur, et l'idéologie des “missions civilisatrices” comme fondement avoué des colonisations, alors que le roman est supposé se dérouler au xxie siècle puisqu'il y est question de « six milliards d'hommes prévus en 2072 »
.
des Aventures maritimes
Tous les romans de Jules Verne qui mettent en scène une “merveille technique” ou une “invention” ne se terminent pas par une explosion, ou une désagrégation. Parfois par la “folie des Hommes”, parfois par un phénomène naturel — ou plus simplement parce que Jules Verne se trouve dans la difficulté d'imaginer les bouleversements que cette invention, réalisée, entraînerait dans le domaine social. Donc, la merveille une fois posée et admirée, le dénouement du récit implique sa disparition.(8)
Ici, les moyens romanesques pour y parvenir sont de divers ordres. D'une part, la rivalité entre les deux plus gros nababs, le Yankee Jem Tankerdon (« La physionomie de ce Yankee est au plus haut point expressive — toute en dehors —, la physionomie de gens qui ne doutent de rien »
) et le “sudiste” Nat Coverley. Fort heureusement, Diana Coverley, la fille du Sud, et Walter, le fils Tankerdon, permettront, après quelques péripéties de type Montaigus/Capulets, une sorte de happy end hollywoodien — en Nouvelle-Zélande. Entre-temps, le quatuor aura vécu une battue aux bêtes sauvages, arrivées dans l'île on ne sait trop comment. Il aura survécu à une attaque de pirates — de sournois Malais, accueillis “à bord” et qui, profitant de l'hospitalité, tentent de conquérir et de piller l'île. Cette dernière sera sauvée par les habitants d'une « colonie française en voie de prospérité […] et un millier d'indigènes soumis à leur influence »
(p. 282). Épisode après la bataille : si « les cadavres de Malais et des indigènes ont été jetés à la mer »
, il n'en est pas de même des citoyens morts pour la défense de l'île. Leurs corps, pieusement recueillis, conduits au temple ou à la cathédrale, y reçoivent de justes honneurs. Puis, sur un steamer, on emporte « les précieuses dépouilles vers une terre chrétienne »
(p. 284).
Mais la véritable cause de la catastrophe est interne et humaine. La compagnie Standard Island ayant fait faillite, elle est rachetée à parts égales par les deux nababs. L'un s'installe à tribord, l'autre à bâbord, chacun maître d'un port et des hélices afférentes. Cela rappelle Swift et la rivalité affichée des gros-boutiens et des petits-boutiens, avec en plus ici la rivalité entre Yankee et Sudiste. En effet, chacun des deux « malfaisants nababs de Milliard City »
(p. 301) donne l'ordre d'aller dans une direction différente et l'île commence alors à tourner sur elle-même. Puis les chaudières de bâbord sautent avec les bâtiments de la machinerie et l'électricité vient à manquer dans cette partie de l'île. Les deux hélices opposées, tirant chacune de son côté, ont fragilisé Standard Island qui peu à peu se disjoint et devient alors un simple radeau qui ne résiste pas à l'arrivée d'un cyclone. « De la merveilleuse Standard Island il ne reste plus que des morceaux épars, semblables à des fragments sporadiques d'une comète brisée qui flottent non dans l'espace mais à la surface de l'immense Pacifique »
avec « quatre mille naufragés »
(p. 308-309).
Fort heureusement les caprices maritimes ramènent près du “radeau” une part entière de l'île, le côté de tribord, avec ses survivants. Poussé par les courants, ce vestige voguera jusqu'aux abords d'Auckland, où se célébrera le mariage de Diana et Walter.
Le texte hésite entre deux types d'explication pour la disparition de la “merveille”. D'une part, la cause proprement humaine, la rivalité des deux « malfaisants nababs »
qui entraîne effectivement la perte de l'île : « Eh bien ! sont-ils satisfaits, ces Coverley, ces Tankerdon, des résultats dus à leur coupable rivalité. »
(p. 308). D'autre part, la dénonciation de l'hybris technologique, sur quoi se termine le texte : « On ne saurait trop le répéter, créer une île artificielle, une île qui se déplace à la surface des mers, n'est-ce pas dépasser les limites assignées au génie humain, n'est-il pas défendu à l'Homme, qui ne dispose ni des vents ni des flots, d'usurper si témérairement sur le Créateur. »
(p. 317).(9)
L'Île à hélice est un texte fascinant par tout ce qu'il révèle de l'“encyclopédie” de l'auteur — au sens que donne à ce mot Umberto Eco. On perçoit les références factuelles comme les présupposés idéologiques, le tout présenté comme allant de soi. On saisit les scénarios employés pour dynamiser l'action : rivalités sur fond d'oppositions qui se déclinent ensuite en intrigues (Nord/Sud ; Catholiques/Protestants ; colonisateurs/indigènes ; peuples civilisés/races inférieures ; île des nantis/pirates voleurs). À quoi s'ajoutent les références culturelles ironiquement sous-jacentes : Swift, Shakespeare et la Bible, à propos des limites assignées à l'Homme, sans oublier la place accordée généreusement à tout ce qui est Français — et donc de bon goût. Notons enfin qu'à la différence de Deux ans de vacances, où le jeune Étasunien intervenait pour rétablir l'ordre entre les Français et les Anglais, ou bien des nombreux textes où les Étasuniens sont présentés comme des ingénieurs, des créateurs, ce sont ici des « rentiers »
, et de simples et « malfaisants nababs »
qui n'hésitent pas à mettre en péril des milliers de passagers pour des questions d'amour-propre. Richissimes possesseurs de pétrole et capitaines d'industrie blasés, il ne leur reste pour se sentir vivre que ces joutes narcissiques. Arrivé en Nouvelle-Zélande, le mariage conclu, le quatuor reprend sa route, un moment interrompue par cet enlèvement, et va continuer à « initier les Américains aux douces et ineffables jouissances de la musique de chambre »
.
- Mon édition de référence sera : l'Île à hélice (1895). Paris : Union Générale d'Éditions › 10|18, 1978.↑
- Le nombre d'exemplaires vendus est de 7000 au dernier relevé de 1904 effectué par Jules Verne. Il est à comparer au 108 000 du Tour du monde en quatre-vingts jours. Cité par Charles-Noël Martin dans la Vie et l'œuvre de Jules Verne. Paris : Michel de l'Ormeraie, 1978, p. 280.↑
- Le compte rendu sous forme de récit de voyage sera publié en 1871 sous le titre une Ville flottante, illustré par un frontispice de Ferrat qui montre un vaisseau qui possède six mâts et des roues à aube. Ce Great Eastern, Jules Verne l'avait vu quelques années plus tôt en construction à Londres.↑
- Cité par Charles-Noël Martin : op. cit., p. 161.↑
- Élisée Reclus : la Terre, description des phénomènes de la vie du globe (1867-1868). Voir la description des Marquises.↑
- Il serait intéressant de comparer les descriptions des Marquises à celles de Melville dans Taïpi (1846).↑
- Le nº 675 de la revue Sciences et avenir (mai 2003) présente un projet d'île flottante intitulé AZ, avec schéma. Elle possède un lagon intérieur au 18e étage. Ses dimensions sont de 40 m de long sur 300 m de large. Elle est stabilisée par 300 000 tonnes d'eau en fond de cale. Rappelons cependant que l'île à hélice mesure 3 km dans sa plus grande longueur et qu'elle ne fait pas que flotter : elle se meut.↑
- On voit là ce qui distingue, de ce point de vue, Jules Verne du H.G. Wells de la Machine à explorer le temps. 1895, à la même date que l'Île à hélice.↑
- Jules Verne, sans doute pour donner une vraisemblance à son histoire, doit passer sous silence l'existence de la radiophonie, qui date de 1880, quinze ans avant ce texte. Et de la télégraphie sans fils (TSF), qui date de 1884. Chose qu'il ne pouvait ignorer, et qui conduit à s'interroger sur ses rapports aux sciences et aux techniques dans le cadre de la création des mondes de ses romans que l'on a qualifié d'“anticipation”.↑